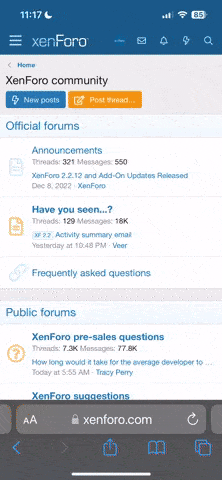Choix de langues au Maroc
L'étape coloniale a représenté un tournant significatif dans l'histoire linguistique du Maroc, dans la mesure où elle avait pour but de refaçonner la culture linguistique historique marocaine et de changer les attitudes des locuteurs vis-à-vis de leur(s) langue(s) et celle du colonisateur. La culture linguistique historique se caractérisait surtout par une coexistence non conflictuelle et une complémentarité entre la langue arabe standard (langue du Coran, de l'école et du savoir) et les langues vernaculaires (amazighe et arabe marocain), utilisés dans diverses fonctions de communication, de littérature, d'art et de savoir, sans qu'il y ait généralement une intention consciente de compétition ou de conflictualité.
Le rôle des langues étrangères, bien qu'utile, est resté normalement marginal, la langue de l'élite étant l'arabe standard ou moyen pour les situations formelles, la littérature et le savoir, et l'amazighe et l'arabe marocain pour des fonctions non moins importantes.
La conception coloniale a été marquée par un désir de redistribution des fonctions: le français comme langue première moderne de l'école, de la littérature, de la pensée et du savoir modernes, l'arabe dit classique comme langue liturgique et langue de textes classiques, l'arabe marocain et le berbère comme dialectes vernaculaires vivants. Cette distribution rigide des fonctions de chaque langue a constitué une nouvelle approche de la donne linguistique, où la délimitation imposée des fonctions de chaque langue était bien entendu en faveur de la langue coloniale, sans qu'il y ait convivialité ou complémentarité spontanée et consensuelle.
La dominance de la langue coloniale en termes de prestige et de chances est doublée d'une taxonomie imposée à l'intérieur du domaine identitaire: la langue du Coran est conçue comme quasi-morte et les langues vernaculaires sont vivantes et créatives. Refusant à l'arabe standard la possibilité d'être une langue de modernité et de savoir, on lui refuse également celle d'être une langue de la vie. L'élite marocaine, constituée surtout par des savants religieux et quelques nationalistes des écoles publiques (francisées) a donc réagi négativement et vivement à cette conception.
L'indépendance a réitéré une opposition musclée à la conception coloniale, prônant une arabisation massive des services publics, y compris l'enseignement, faisant (hâtivement) du français la langue du colonisateur. En 1970, l'élite marocaine représentée par des savants religieux et une élite moderne bilingue ou francisée a signé un mémorandum historique dénonçant la mainmise du néo-colonisateur sur le Maroc par l'intermédiaire de sa langue. Cet appel est resté, cependant, lettre morte, et les tergiversations et batailles entre francisation et arabisation n'ont jamais cessé.
Pire, l'histoire a révélé un double langage hypocrite de l'élite: le français pour ses fils et l'arabe pour celui des autres, tout en croyant que l'un était un privilège et l'autre une punition. L'arabe standard est alors devenu au niveau de cette élite une langue plus dénigrée qu'au temps du protectorat. Son aménagement de statut et surtout de corpus n'avait subi que déboires et atermoiements. En même temps, l'amazighe était resté hors d'un système qui s'inspirait de la culture linguistique jacobiniste en France: un état/une nation/une langue. L'arabe dialectal marocain, quant à lui, devenait positionné en termes de référence coloniaux. L'exclusion, la discrimination, la suspicion et la minoration devenaient alors une réalité de notre (in)culture linguistique nouvelle.
A partir de la Charte d'Education et de Formation, du Dahir portant création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe et de celui instituant l'Académie Mohammed VI de langue arabe, des textes de référence nationaux approuvés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les représentants de la Nation décidaient de donner des orientations claires en matière de politique linguistique et éducative: un renforcement et une revalorisation de l'arabe standard, une ouverture et une revalorisation du tamazight et une reconnaissance du droit à la langue étrangère. En gros, trois types de droits en matière de langue étaient reconnus: le droit à la langue nationale officielle, le droit à la langue maternelle (et à la diversité linguistique culturelle) et le droit à la langue étrangère comme langue (non-exclusive) d'ouverture et de progrès.
Ce progrès substantiel au niveau du cadre de référence politique et éducatif ne fut pas suivi au niveau de l'application. Alors que l'Institut Royal de la Culture Amazighe a été mis sur pied et l'enseignement de l'amazighe introduit dans le système d'éducation, le français réhabilité et renforcé à partir de la seconde année du primaire (en même temps que dans les médias, l'administration, etc.), l'arabe n'a bénéficié d'aucun programme permettant d'appliquer les dispositions de la Charte ni de la loi constitutive de l'Académie. Bien que la Charte ait été conçue comme globale et indivisible, un double langage, caractéristique d'une période de démagogie passée, s'est donc réinstallé.
En d'autres termes, quoique la Charte donne l'impression que le Maroc a changé de culture linguistique, celle de l'exclusion, de la discrimination, du refus d'une politique affirmée et d'une autre appliquée, les choses n'ont changé malheureusement que de forme, pas d'esprit, aux dépens de la langue nationale officielle. L'Etat tergiverse toujours pour ramener les pendules à l'heure, laissant la porte ouverte à des débats chaotiques qui ne relèvent pas de choix globaux, mais uniquement de choix partisans, voire mercantilistes.
Les textes de lois, dahirs et textes de référence approuvés à l'unanimité par la Nation et son Souverain sont bafoués ou non appliqués et l'action gouvernementale est tributaire d'une pragmatique occasionnelle et de surenchères. Une politique linguistique globale claire est nécessaire pour dépasser les impulsions et dépassionner beaucoup de débats pour que le pays se mette à travailler sérieusement et fermement. Remettre aux calendes grecques l'application de choix globaux crée de nouveaux déséquilibres chaque jour et assombrit une vision qui avait tendance à devenir claire.
Le modèle de gestion linguistique à 3L (langue nationale officielle, langue nationale maternelle et langue universelle), dont les grandes lignes se dégagent de la Chartre a l'avantage de répondre à trois dimensions linguistiques minimales et en même temps de fixer un SMIG linguistique qu'on doit se fixer comme objectif précis, à réaliser de manière réussie. On peut broder longtemps sur le plurilinguisme, mais le fait est qu'aucun pays du monde n'est sauvagement plurilingue. Un modèle à 3 L est viable et nécessaire pour le Maroc, son équilibre et son développement. C'est à l'Etat d'assurer la viabilité de ce modèle, son respect et sa cohésion.
Choisir un modèle explicite à 3 L constitue une rupture par rapport à la période coloniale et postcoloniale où beaucoup de choix ont été faits en termes d'exclusion, de discrimination et de minoration non justifiés. L'arabisation, telle que conçue et appliquée, était elle-même discriminatrice et paradoxalement en défaveur de l'arabe. Au niveau de son corpus, l'arabe a été traité comme une langue dont le vocabulaire général ou technique n'est pas précis, ne couvre pas tous les éléments d'un champ sémantique, etc.
Il en est de même de ses textes et de ses contenus. C'était donc à partir de la langue étrangère uniquement, et non de l'intérieur, qu'on a conçu son réaménagement, le plaçant de facto dans une position de dépendance et d'infériorité. La même chose peut être dite de la formation de ses maîtres, de sa didactique, etc. L'arabisation n'a jamais été planifiée à différents niveaux pour qu'elle réussisse.
Concevoir même que l'arabe est là pour se substituer au français dans toutes ses fonctions est une aberration, l'inverse étant vrai pour le français. L'arabisation associée à la libération et à la fierté s'est vite transformée en cliché de langue handicapée qui forme des incompétents avec peu de chances pour réussir dans la vie active. L'inculture linguistique s'était donc installée, de bonne ou surtout de mauvaise foi. C'était oublier que toutes les langues connaissent des difficultés et que le travail d'aménagement sérieusement conçu et planifié est nécessaire pour soutenir toutes les langues, y compris les langues les plus dominatrices.
Il est facile de prétendre que l'arabisation a échoué au Maroc, alors qu'on sait que l'arabe n'est qu'une partie d'un tout, d'une politique linguistique ratée et qui continuera à l'être tant qu'on n'a pas fait et réalisé des choix clairs et globaux.
Résoudre le problème linguistique de manière globale est le gage de réussite de toute politique. L'émiettement crée des disparités et des déséquilibres constants. L'exclusion de l'arabe dans l'application de textes de référence unanimement approuvés est un indicateur fort du fossé entre la situation de jure et de facto des langues, la manifestation d'un comportement double qui n'est pas caractéristique de la modernité.
Tout en prétendant être moderne et nouvelle, la politique actuelle est en fait dans la stricte continuité du passé, faisant usage de discrimination, d'exclusion et pêchant par manque de légitimité et de démocratie.
Un plurilinguisme est géré par des lois et les textes de référence qui le réglementent. Ce n'est pas en allongeant la liste de nos diversités linguistiques qu'on y parviendra.
C'est une démarche de l'autruche qui aggravera les déséquilibres, tout en s'éloignant des textes de référence et de lois. Une gestion sur la base d'un modèle à 3L doit être minimalement assurée par l'Etat.
Plus de diversité est concevable, pour les langues étrangères et les langues identitaires, mais elle n'est pas nécessairement du ressort de l'Etat. Un type de diversité devrait relever de la région ou de l'école, dans le respect des lois linguistiques pertinentes, notamment celles qui protègent et réglementent la distribution et la cohésion des 3L. Le marocain doit pouvoir être fier de sa langue nationale officielle, de sa langue maternelle, de la langue universelle qu'il apprend sans qu'on dénigre l'une ou l'autre et sans que l'une soit conçue pour minorer l'autre.
Il est facile d'émettre des jugements provocateurs et stériles sur les langues. Il est plus intéressant de penser à des langues dans un environnement sain, facilitant la communication, le développement, le progrès et la cohésion linguistique, culturelle et sociale.
Abdelkader Fassi
est linguiste