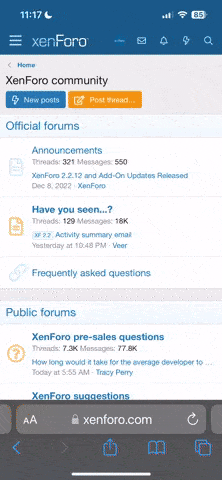Agraw_n_Bariz
New Member
1-LANGUE BARBERE COMMUNE ET DIALECTES
Le berbère actuel constitue dans ses multiples dialectes l’héritage direct d’une langue commune dont on doit situer le foyer et l’origine lointaine en Basse Egypte et en Libye actuelle (autour de -3500, pour le protoberbère ancien). Cette langue, le protoberbère commun, est la forme que devait prendre la langue berbère avant son éclatement. Les dialectes historiques connus et ou éteints en constituent les formes divergentes ayant évolué séparément et dont les contacts se sont raréfiés au cours du temps. Les multiples déplacements historiques des premiers groupes berbérophones, à l’intérieur du Maghreb, ont amené toutefois ces groupes à rentrer de nouveau en contact. Aussi peut-on observer, sur certaines aires au moins des recouvrements, superpositions et autres enchevêtrements qui rendent le travail de classement problématique. C’est cet ensemble unitaire de “dialectes” issu d’une langue mère par différenciation progressive, dialectisation, superposition ou fusions locales que l’on désigne par “langue berbère”. Le berbère ne dispose pas d’une langue standardisée commune et aucune “langue régionale” n’a pu s’imposer aux dépens des autres. Mais ce sont historiquement formées, ici et là, des aires sociolinguistiques relativement vastes pour peu que la communication n’ait pas été rompue par la distance géographique ou par l’arabe dialectal. Il semble y avoir eu anciennement entre différentes zones des solutions de continuité ou de transition plus nombreuses qu’aujourd’hui.
Extraits d'un article de B. Zoulef.
Le berbère actuel constitue dans ses multiples dialectes l’héritage direct d’une langue commune dont on doit situer le foyer et l’origine lointaine en Basse Egypte et en Libye actuelle (autour de -3500, pour le protoberbère ancien). Cette langue, le protoberbère commun, est la forme que devait prendre la langue berbère avant son éclatement. Les dialectes historiques connus et ou éteints en constituent les formes divergentes ayant évolué séparément et dont les contacts se sont raréfiés au cours du temps. Les multiples déplacements historiques des premiers groupes berbérophones, à l’intérieur du Maghreb, ont amené toutefois ces groupes à rentrer de nouveau en contact. Aussi peut-on observer, sur certaines aires au moins des recouvrements, superpositions et autres enchevêtrements qui rendent le travail de classement problématique. C’est cet ensemble unitaire de “dialectes” issu d’une langue mère par différenciation progressive, dialectisation, superposition ou fusions locales que l’on désigne par “langue berbère”. Le berbère ne dispose pas d’une langue standardisée commune et aucune “langue régionale” n’a pu s’imposer aux dépens des autres. Mais ce sont historiquement formées, ici et là, des aires sociolinguistiques relativement vastes pour peu que la communication n’ait pas été rompue par la distance géographique ou par l’arabe dialectal. Il semble y avoir eu anciennement entre différentes zones des solutions de continuité ou de transition plus nombreuses qu’aujourd’hui.
Extraits d'un article de B. Zoulef.