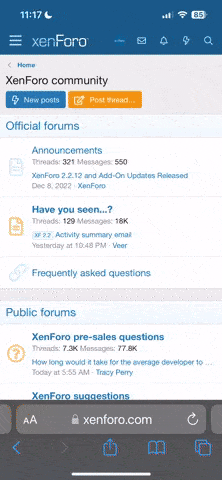Lorsqu’un groupe social est tenu à l’écart des cercles de réflexion collective, des lieux d’influence et des centres de décision, il va «naturellement» se doter de moyens de parole réduits parce qu’ils constituent la réponse linguistique pertinente à la situation culturelle et sociale réduite qui lui est imposée. C’est en effet l’ambition que l’on nous autorise qui règle notre envie et notre capacité de conquérir le verbe. Pour oser parler, pour avoir l’audace d’aller chercher par la parole l’autre au plus loin de soi-même, il faut avoir compris ce que parler veut dire. Il faut être sûr que parler constitue plutôt une promesse qu’une menace ; savoir qu’une chance réelle existe d’exercer un peu d’influence sur le monde. Plus étroit est le « cercle de parole », plus faible en est la maîtrise et plus grande est la crainte à se hasarder au-dehors. Car lorsque les occasions de parler de choses nouvelles à des gens nouveaux ont été quasi inexistantes tout au long de l’apprentissage de la langue, cela a induit un rétrécissement du langage qui interdit de parler «au large». Et lorsque exceptionnellement la nécessité se fait sentir d’affronter l’inconnu, les moyens linguistiques ne sont pas là pour le permettre. C’est donc bien la marginalisation culturelle et sociale qui engendre l’insécurité linguistique; mais la réduction des outils lexicaux, grammaticaux et discursifs qui en résulte rend cet enfermement de plus en plus sévère et de plus en plus faibles la volonté et les chances d’évasion.
Alain BENTOLILA
source : http://www.leconomiste.com/article.html?a=76076
Alain BENTOLILA
source : http://www.leconomiste.com/article.html?a=76076