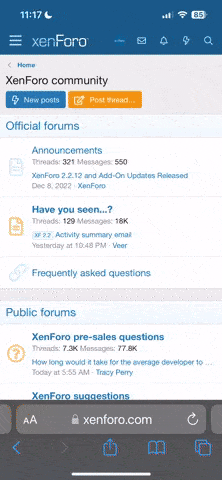Nouvelle livraison de Prologues
L'amazighe : les défis d'une renaissance
Numéro double 27/28
Editorial
L'amazighe : les défis d'une renaissance
L’amazighe constitue la langue autochtone au Maghreb. Elle est parlée par des dizaines de millions de personnes sous forme de dialectes non standardisés et employée pour des besoins de communication essentiellement orale. Avec l’émergence d’une conscience identitaire organisée, les amazighophones aspirent à valoriser leur langue et leur culture jusqu’ici minorée de facto sur le plan institutionnel par son exclusion de l’enseignement, des médias et de la vie publique.
A présent, les Etats maghrébins semblent plus disposés à considérer le bien-fondé de ces revendications en créant des institutions spécialisées, le Haut Commissariat à l’Amazighité HCA) en Algérie et l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) au Maroc et en intégrant (partiellement) l’amazighe dans l’enseignement et dans les médias. La survie de la langue et de la culture amazighes dépend certes largement de la volonté politique quant au statut institutionnel de la langue mais aussi de la résolution de questions techniques relatives à l’aménagement du corpus de la langue. Aussi l’enjeu est-il considérable.
Cette situation inédite met l’amazighophonie au défi de répondre aux exigences de la vie moderne, notamment le passage de l’oralité vers la scripturalité et la mise à niveau de la langue. Or les attentes sont immenses et diverses, et les besoins non moins importants : l’adoption d’une graphie adéquate et son adaptation en une notation usuelle, la standardisation de la langue et la modernisation de ses structures.
Les expériences de création néologique et terminologique ne manquent pas. Elles contribuent certes à répondre à une demande sociale souvent pressante en comblant certaines lacunes lexicales mais elles pèchent parfois par excès de volontarisme et d’amateurisme. Cette situation s’explique en partie par l’absence de cadre(s) ayant vocation de pôle de normalisation institutionnelle adoptant une stratégie globale et raisonnée en matière d’aménagement de la langue et permettant de gérer en amont comme en aval la production néologique et terminologique.
L’aménagement linguistique dans le domaine amazighe a fait l’objet de quelques rencontres scientifiques qui ont permis de jeter les jalons d’une réflexion et d’une action notamment dans les domaines de la notation graphique et de la néologie lexicale. Le travail amorcé mérite d’être approfondi par l’échange en matière d’élaboration de la stratégie (processus de standardisation, principes et priorités) et de la méthodologie (modalités de la normalisation de la notation graphique et de la création lexicale) et en matière d’évaluation de la production terminologique, principalement dans des domaines cruciaux comme l’enseignement et les médias.
Prix de vente : 50 DH - Algérie 70 DA - Tunisie 7 DTU - Europe 8 - Canada 12$ CAN - Autres pays 10$ US
SOMMAIRE
DOSSIER
Introduction
L'amazighe: défis et enjeux d'une renaissance
Ahmed BOUKOUS et Aïcha BOUHJAR
De l'aménagement dans le domaine amazighe
Meftaha AMEUR et Aïcha BOUHJAR
Norme graphique et prononciation de l'amazighe
El Mehdi IAZZI
La néologie lexicale en amazighe marocain
Fatima BOUKHRIS
Tradition berbérisante et prémices de la standardisation de l’amazighe
Aziz KICH
Des écueils du passage à l’écrit de l’amazighe
Fatima AGNAOU
L’alphabétisation en amazighe : un levier du développement durable
Jilali SAIB
Des méthodes de l’enseignement de l’amazighe : examen rétrospectif et prospectif
COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
Par El Mehdi Iazzi
Par Aïcha Bouhjar
Par Hassan Ouzzate
Par Meftaha Ameur
DEBATS
Driss Almou
Impact de l’alphabétisation sur la qualité de vie des amazighophones
Hennou Laraj
L’importance de la langue maternelle dans l’éducation préscolaire
Mohamed ELMEDLAOUI
Le berbère et l’histoire du pluralinguisme au Maghreb (le cas du Maroc)
Ali Boulahcen
Disparités sociolinguistiques et socioculturelles du système éducatif au Maroc
Anne Balenghien, Mohammed Benjelloun Touimi, Sabine Kilito, Anne-Marie Teeuwissen
Couple mixte installé au Maghreb
Mohamed MOUAQIT
De l’élite, de la passion de la liberté et de la mystification
ARTICLES EN ARABE
DOSSIER
Mohamed Chafik
Existe-t-il un amazighe classique ?
Ahmed Boukous
L’amazighe dans le système éducatif : principes et orientations
Mohamed Elmedlaoui
De la « notation usuelle du berbère » à « l’orthographie amazighe » (processus d’un projet de normalisation d’une langue)
Boudriss Belaïd
L’amazighe et la mise à niveau du système éducatif
Abderrahmane Belouch
L’abc du tifinaghe et la question de son enseignement
COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
Par Hussein MOUJAHID
Par Hussein WAAZI
DEBATS
Mohamed Ghnaim
L’aménagement de la langue au Maroc
Jamal Bendahman
L’amazighe : langue, écriture et enjeux de l’identité
Abdelilah Salim
La planification linguistique au Maroc : le corpus amazighe comme modèle
Meriam Demnati
L’enseignement et la langue maternelle
Ahmed Assid
Les études amazighes à l’université : évaluation critique
Rachid Moqtadir
Les mouvements protestataires : le mouvement amazighe et le mouvement islamiste, une première approche des ressemblances et différences
Mohamed AQDAD
Introduction à l’étude du conte populaire amazighe : le modèle du Rif
Rachid Idrissi
L’histoire amazighe : l’événement et l’idéologie
--------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER
Introduction
L'amazighe: défis et enjeux d'une renaissance
Ahmed BOUKOUS et Aïcha BOUHJAR : De l'aménagement dans le domaine amazighe
Longtemps ignoré dans la politique linguistique et culturelle officielle, l’amazighe bénéficie depuis 2001 d'une reconnaissance institutionnelle avec la création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM). L'implémentation de l'option stratégique de la standardisation de l'amazighe impose néanmoins des choix méthodologiques qui ne sont pas sans contraintes, notamment dans les domaines de la normalisation de la phonie et du lexique, et de la codification de la graphie.
Meftaha AMEUR et Aïcha BOUHJAR : Norme graphique et prononciation de l'amazighe
Dans la perspective d'un amazighe standard commun aux diverses variétés dialectales en vigueur, à construire sur la durée, ce texte décrit les caractéristiques phoniques sous-jacentes à l’alphabet tifinaghe élaboré par l'IRCAM en tant que graphie officielle de la langue amazighe au Maroc. L'exposé des critères de sélection des phonèmes retenus est suivi d'un relevé des processus phonético-phonologiques neutralisés par la graphie.
El Mehdi IAZZI : La néologie lexicale en amazighe marocain
L’aménagement en amazighe marocain, qui s’est développé en dehors de tout cadre institutionnel officiel depuis le début des années 90, a porté essentiellement sur le statut de la langue. Il marque une évolution de la conscience identitaire du mouvement amazighe. Avec la néologie lexicale, l’intervention porte sur le corpus de la langue pour le rendre apte à l’expression de la modernité. Tout en enrichissant de manière endogène la langue, cette intervention pose le problème de la standardisation et de l’unité des parlers amazighes.
Fatima BOUKHRIS : Tradition berbérisante et prémices de la standardisation de l’amazighe
Le présent texte explique, d’une part, comment la tradition berbérisante a appréhendé la question de l'unité et de la diversité de la langue amazighe et explicite, d’autre part, les choix méthodologiques et les principes à retenir dans la standardisation de la langue commune.
Aziz KICH : Des écueils du passage à l’écrit de l’amazighe
Même quand seront résolus les problèmes respectifs de la volonté politique et des techniques liés à l’aménagement de l’amazighe, demeurera posée pour longtemps la question de savoir à quel écrit on veut passer. Ce passage risque, si l’on n’y prend garde, de donner naissance à un être nouveau et étrange dans lequel les amazighophones actuels ne se reconnaîtront pas. Il doit donc s’inscrire dans une vision globale consciente, qui en rythme la vitesse en opérant les choix stratégiques qui s’imposent.
Fatima AGNAOU : L’alphabétisation en amazighe : un levier du développement durable
La question de l’intégration de l’amazighe dans l’enseignement et dans le domaine de l’éducation des adultes est à l’ordre du jour. Le présent article argumente en faveur de l’alphabétisation en amazighe comme levier du développement durable et propose les modalités de l’implémentation d’une stratégie qui vise à la fois la valorisation de la personne et l’éducation du citoyen.
Jilali SAIB : Des méthodes de l’enseignement de l’amazighe : examen rétrospectif et prospectif
L’enseignement de l’amazighe est à l’ordre du jour. C’est pourquoi il convient d’en élaborer les méthodes d’enseignement en tenant compte à la fois des méthodes utilisées antérieurement pour l’enseignement de l’amazighe et des acquis et apports récents des sciences de l’éducation.
COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
Par El Mehdi Iazzi
A propos de Achab, Ramdane : La néologie lexicale berbère (1945-1995), Paris/Louvain : Ed. Peeters, collection, « M.S. – 9 – Ussun amari », 1996, 367p., préf. de S. Chaker.
Par Aïcha Bouhjar
A propos de Achab, Ramdane : Langue berbère – Introduction à la notation usuelle en caractères latins, Paris : Ed. Hoggar,1998.
Par Hassan Ouzzate
A propos de Arnaiz-Villena, Antonio (Ed.) : Prehistoric Iberia : Genetics, Anthropology, and Linguistics, New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
Par Meftaha Ameur
A propos de Haddachi, Ahmed : Dictionnaire de Tamazight. Parler des Ayt Merghad (Ayt Yafelman), Salé : Imprimerie Béni Snassen, 2000.
DEBATS
Driss Almou : Impact de l’alphabétisation sur la qualité de vie des amazighophones
Loin d’être aujourd’hui un simple apprentissage de l’écriture, de la lecture et du calcul, l’alphabétisation est devenue une véritable entreprise dont le but ultime est l’amélioration de la qualité de vie des populations visées, notamment celle vivant en milieu rural. C’est l’idée fondamentale que développe l’auteur dans l’article ci-après. Aussi au Maroc, une alphabétisation des amazigophones dans sa conception classique, et en arabe qui plus est, a peu de chances de produire les résultats escomptés en termes de changement et d’un cadre de vie meilleur pour les populations concernées.
Hennou Laraj : L’importance de la langue maternelle dans l’éducation préscolaire
Dans l’article ci-dessous, l’auteur montre les vertus affectives, sociales et intellectuelles de l’usage de la langue maternelle – en l’occurrence l’amazighe pour les enfants amazigophones – dans l’éducation préscolaire. Aussi souligne-t-il l’importance capitale de la conception d’un préscolaire national et moderne où la langue maternelle des enfants prendra la place qui lui revient.
Mohamed ELMEDLAOUI : Le berbère et l’histoire du pluralinguisme au Maghreb (le cas du Maroc)
Pour l’auteur de l’article qui suit le pluralisme linguistique au Maghreb est une réalité très ancienne qui remonte à l’Antiquité, mais le rôle assigné à chaque époque aux différentes langues concurrentes a été déterminé moins par un rapport de force à base éthnique que par une dialectique à caractère idéologique et axiologique à l’échelle de la Méditerranée toute entière. La gestion de cette donnée linguistique aujourd’hui dont le renouveau constitue un indice significatif du rééquilibrage sociolinguistique en cours doit s’inscrire désormais, selon l’auteur, dans une stratégie moderne d’enseignement et de communication qui vise moins, comme par le passé, à reproduire idéologiquement l’ordre social dominant, qu’à mobiliser les ressources nécessaires au développement socio-économique, conçu en soi comme valeur suprême.
Ali Boulahcen : Disparités sociolinguistiques et socioculturelles du système éducatif au Maroc
Comment et dans quelle mesure le système éducatif marocain, tel qu’il est aujourd’hui, détermine-t-il les chances d’accès et de succès des jeunes à la fois à l’école et dans la vie professionnelle et sociale ? C’est à cette question cruciale que tente de répondre l’auteur dans l’article qui suit, en mettant en relief le caractère antagonique de classe de l’enseignement au Maroc. Les procédures pédagogiques héritées du passé colonial ont en effet, selon lui, fait de l’école du type franco-arabe un champ de bataille entre deux langues et donc deux cultures, dont l’affrontement quotidien ne profite en fin de compte qu’à une minorité de privilégiés.
Anne Balenghien, Mohammed Benjelloun Touimi, Sabine Kilito, Anne-Marie Teeuwissen :
Couple mixte installé au Maghreb Dans l’article ci-après les auteurs engagent une réflexion qui, par-delà les drames indéniables que vivent les femmes non musulmanes au sein des couples mixtes installés au Maghreb, et par-delà aussi l’exemple que pourrait représenter le couple mixte pour une mutation au sein du groupe « ordinaire », soulève des questions plus fondamentales qui concernent la liberté de conscience et le statut des femmes en terre d’islam.
Mohamed MOUAQIT : De l’élite, de la passion de la liberté et de la mystification
Pourquoi l’élite dans le monde arabo-musulman n’a-t-elle pas la passion de la liberté ? Pourquoi sacrifie-t-elle toute aspiration à la liberté des individus sur l’autel d’un mythique âge d’or à restaurer ? N’est-ce pas là que réside peut-être l’explication majeure des impasses, échecs et déceptions du monde arabo-musulman ? Ce sont ces interrogations qui constituent la trame de cet article où l’auteur s’élève contre certaines analyses qui au lieu de se réjouir de la chute d’un régime de terreur – tout en refusant moralement bien sûr la guerre qui en a été la cause – érigeant Saddam Hussein au rang d’un martyr résistant et mystique (messianique), justifiant et purifiant ainsi un régime sanguinaire, simplement parce qu’il s’est paré d’une idéologie/discours de renaissance arabe.
ARTICLES EN ARABE
DOSSIER
Mohamed Chafik : Existe-t-il un amazighe classique ?
Dans cet article l’auteur pose le problème de la pédagogie de l’enseignement de l’amazighe en maternelle et dans l’enseignement fondamental, se demandant s’il existe, à l’instar de l’arabe, un amazighe non dialectal, un amazighe « classique », c’est-à-dire scolaire, susceptible d’être à la fois objet et moyen d’enseignement. Si l’auteur pense que la recherche d’un amazighe classique dans un « âge d’or condamné à revenir » relève du mythe, il n’en croit pas moins que l’amazighe pourrait rejoindre le groupe des langues classiques, et que cela est à la portée des Amazighes si on leur permet d’exercer leur auto-détermination culturelle et linguistique. A cet effet l’auteur montre quelques méthodes et donne quelques conseils pédagogiques susceptibles d’aider à la réalisation d’un tel projet.
Ahmed Boukous : L’amazighe dans le système éducatif : principes et orientations
Dans le cadre de la nouvelle conception de l’établissement d’enseignement, il a été décidé d’intégrer l’amazighe dans le système d’éducation à partir de la rentrée scolaire prochaine. Cette décision soulève des questions de fond, notamment celles relatives aux raisons qui l’ont motivée, aux principes et orientations qui la commandent et aux mécanismes destinés à aider à sa mise en œuvre.
Mohamed Elmedlaoui : De la « notation usuelle du berbère » à « l’orthographie amazighe » (processus d’un projet de normalisation d’une langue)
Après avoir rappelé brièvement la dynamique socio-culturelle qui a conduit à la révision en cours du cadre qui définit le statut et la fonction de la langue amazighe au Maroc (première partie), l’auteur, dans l’article ci-après, met l’accent sur le rôle décisif que joue l’établissement des bases de l’orthographie – en tant qu’institution socio-linguistique et académique – dans toute opération d’envergure qui consiste à normaliser et unifier une langue donnée (deuxième et troisième parties). L’auteur souligne également le lien solide et étroit qui existe toujours – comme le montrent les systèmes orthographiques connus (arabe, hébreu, français, anglais, allemand) – entre tout système orthographique (liste des lettres et conventions phonétiques) et la situation de la langue originaire abstraite dont découlent et se ramifient du point de vue théorique et historique, tous les dialectes effectifs, lesquels sont considérés comme de simples aspects spécifiques de la langue appelée à être normalisée et unifiée (quatrième partie).
Boudriss Belaïd : L’amazighe et la mise à niveau du système éducatif
Le développement total, dont le développement de l’homme est un des objectifs fondamentaux, constitue le véritable pari de toutes les sociétés. Aussi l’éducation occupe-t-elle une place centrale dans toute planification rationnelle du développement, qu’il s’agisse du développement des ressources humaines, ou économiques. Cette importance réside dans le fait que l’enseignement constitue la porte d’accès essentielle et nécessaire à tout développement volontaire. Et dans le cadre du système éducatif, l’enseignement d’une langue donnée est d’une importance capitale. Surtout lorsqu’il s’agit d’une langue maternelle, car c’est à travers elle que s’inculquent les données du monde extérieur que l’école contribue à organiser avec la participation de l’enfant. C’est à travers elle aussi que s’expriment les différentes activités humaines cognitives, affectives, sociales et culturelles.
Abderrahmane Belouch : L’abc du tifinaghe et la question de son enseignement
Cet article aborde la question de l’abc du tifinaghe comme clef du savoir scolaire, en exposant les grandes étapes historiques qu’a connues cette écriture, jusqu’à la forme qu’on lui connaît actuellement. L’article analyse également les trente trois caractères (signes) sur lesquels s’est porté le choix, en en développant la fonction, les formes et les caractéristiques, pour en arriver finalement à une approche didactique munie de propositions pratiques déduites d’expériences passées.
COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
Par Hussein MOUJAHID
A propos de Chafik, Mohamed : (tome I 1990 ; tome II 1996 ; tome III 2000) : almuâjamu lâarabiyu l'amaaziyghiyu, Rabat : Publications de l'Académie du Royaume du Maroc.
Par Hussein WAAZI
A propos de Ben Younes, Arav : Sortie de secours, une confédération maghrébine, Hull, Quebec, Centre de Promotion Artistique, 2000, 251p.
DEBATS
Mohamed Ghnaim : L’aménagement de la langue au Maroc
L’étude des langues a constitué depuis longtemps un domaine analytique et systémique dans le cadre des études linguistiques. Beaucoup de pays aujourd’hui connaissent une situation linguistique complexe, du fait de la diversité linguistique ou dialectale qui les caractérise. La situation linguistique au Maroc a fait l’objet de nombreuses études fort riches de la part de Marocains et d’étrangers sous des angles linguistiques différents (linguistique interne : syntaxe, morphologie, phonologie et linguistique externe : sociolinguistique, psycholinguistique, pragmatiques). Abdelkader Fassi Fihri est de ceux qui se sont intéressés à ce domaine dans plus d’un ouvrage. L’article ci-dessous essaie de présenter les étapes les plus importantes de son projet qui répond aux nombreuses interrogations que soulèvent la planification et la gestion de la carte linguistique au Maroc.
Jamal Bendahman : L’amazighe : langue, écriture et enjeux de l’identité
Comment le discours amazighe a-t-il traité les problèmes de la langue, de l’écriture et de l’identité ? Quels progrès ont été réalisés à cet égard ? Quels sont les arrières-plans théoriques d’un tel discours ? Est-ce que ses attitudes et visions sont cohérentes ? Quelle est cette identité que l’on défend ? Comment est-ce qu’elle se rapporte aux autres composantes du champ culturel marocain ? L’article qui suit tente d’examiner toutes ces questions à la lumière des textes de spécialistes de l’amazighe dans leur rapport à l’histoire, la langue et la politique. Il traite également du statut juridique de l’amazighe dans le cadre des différents éléments qui composent la carte linguistique marocaine dont la diversité doit être gérée de manière rationnelle et intégrée.
Abdelilah Salim : La planification linguistique au Maroc : le corpus amazighe comme modèle
Si au Maroc les objectifs de la politique linguistique sont clairs et bien tracés, l’on ne saurait en dire autant des moyens et procédures d’intervention et de gestion de la diversité qui restent marqués par certaines tares. Le Maroc possède-t-il une politique linguistique à même de réguler, de développer et de renforcer son tissu linguistique afin d’en éviter le dépérissement ? Si oui, quelle place tient l’amazighe dans cette politique ? La législation marocaine en matière linguistique prend-elle en considération les impératifs de stabilité, d’unité, de diversité et d’ouverture ? L’alphabet utilisé pour écrire l’amazighe, a-t-il un rôle dans son développement et son expansion, ou est-ce que tous les alphabets se valent et produisent les mêmes résultats ? Telles sont les quelques questions auxquelles l’article ci-dessous se propose d’apporter quelques éléments de réponse.
Meriam Demnati : L’enseignement et la langue maternelle
Les experts en pédagogie ont montré depuis longtemps l’importance de la langue maternelle dans la détermination de l’avenir scolaire et social de l’individu. Aussi l’usage et la maîtrise de cette langue dès le préscolaire s’avèrent-ils d’une nécessité impérieuse. C’est ce que soutient l’article ci-après, en prenant pour exemple le cas de l’amazighe dans le système éducatif au Maroc notamment depuis la publication de la Charte de l’éducation et de la formation qui, aux yeux de l’auteur, ne réserve qu’une place secondaire à cette langue. Mais depuis la création de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) une autre politique semble se dessiner tendant vers une meilleure prise en compte de l’amazighe dans le système éducatif.
Ahmed Assid : Les études amazighes à l’université : évaluation critique
Les études amazighes universitaires au Maroc ont-elles produit un cumul de savoir suffisamment dense permettant d’accompagner le tournant pris au niveau officiel de faire passer l’amazighe d’un statut de langue parlée et marginale, à celui d’une langue et d’une culture intégrées dans les institutions officielles d’enseignement et des médias ? C’est la question à laquelle tente de répondre l’article qui suit en jetant un regard critique sur les études et recherches réalisées dans le domaine de l’amazighe à l’Université marocaine entre 1972 et 2000. Si l’auteur relève que des progrès ont été bien enregistrés en ce domaine, notamment depuis les années quatre-vingt-dix, où les études amazighes ont commencé à connaître leur véritable essor, il n’en reste pas moins qu’à ses yeux, ces études rencontrent encore un certain nombre d’obstacles, que l’Institut Royal de la Culture Amazighe pourrait bien aider à surmonter.
Rachid Moqtadir : Les mouvements protestataires : le mouvement amazighe et le mouvement islamiste, une première approche des ressemblances et différences
La décennie quatre-vingt-dix a vu une recrudescence dans la dynamique de ce qui est appelé les mouvements protestataires, suite à une série de changements internes et externes. Le mouvement amazighe participe de cette même dynamique. L’article qui suit est une première contribution éclairant ce mouvement, en analysant le rapport politique-culture dans les discours et conduites de ses militants, tout en le comparant au mouvement islamiste.
Mohamed AQDAD : Introduction à l’étude du conte populaire amazighe : le modèle du Rif
En raison de sa nature et de la place qu’il occupe dans les cultures des peuples, le conte constitue un des domaines de création linguistique les plus importants chez tous les peuples ou communautés. C’est à partir de cette constatation que l’article ci-dessous examine ce qu’il appelle «La Charte du conte» dans le Rif oriental, charte implicite et coutumière qui lie le conteur et le récepteur, et dont l’intermédiaire n’est autre que la société, milieu de circulation du conte et dépositaire de sa charte.
Rachid Idrissi : L’histoire amazighe : l’événement et l’idéologie
L’histoire a été et reste jusqu’aujourd’hui un des instruments utilisés pour légitimer les demandes du présent. Elle est comme une institution chargée de transmettre les valeurs et visions d’une étape historique à une autre. C’est ce que tente de mettre en évidence Rachid Idrissi dans cet article. Mais quel rôle veut-on faire jouer aux événements de l’histoire marocaine aujourd’hui dans le cadre de l’attention portée à la culture et la langue amazighes ? Comment ont composé les Imazighens aux différentes civilisations qu’ils ont connues ? Quels sont les traits de la culture et de la langue amazighes ? Quel a été l’effet de la civilisation arabe et musulman au Maroc ? Et quelles ont été les causes et les conséquences de l’action d’arabisation à laquelle, ont été soumis les Imazighens ? Ce sont là quelques questions auxquelles cet article essaie de répondre cet article à travers la lecture critique des idées contenues dans le livre de Mohamed Chafik.
--------------------------------------------------------------------------------
Abonnement au Maroc = 400 DH - Abonnement étranger = 70 euros
Prix de la collection complète = 600 DH au lieu 1200 DH (offre vablable jusqu'au 31 décembre 2003)
Pour tout information supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat de rédaction au Tél./fax: (212 22) 22 65 20
Ou envoyez votre message à l'adressse suivante : prologue@mtds.com
Source: mondeberbere.com