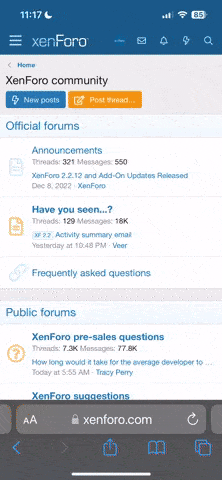Le système représentatif repose sur le postulat que le peuple ne peut matériellement exercer lui-même directement la souveraineté et qu'il est alors nécessaire de confier à des représentants le soin de décider pour lui au nom de la Nation. Initiée par Montesquieu, dans «L'esprit» des lois (1748), reprise par Siéyés en 1789, la démocratie représentative ne se mettra véritablement en place qu'au XIX°s grâce à la généralisation de l'élection des représentants au suffrage universel.
C'est cette conception de la démocratie que retient la constitution marocaine de 1996, son article 2 proclamant que : “ La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles ”. Cette disposition renvoie implicitement à la notion de représentation nationale en vertu de laquelle la Nation exprime sa souveraineté par le truchement de ses représentants en l'occurrence le Roi et le Parlement. Ainsi de l'article 19 aux termes duquel : “ Le Roi, Amir Al Mouminine, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la constitition.
Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques ”. Tandis que l'article 36 précise que les membres du Parlement “ tiennent leur mandat de la Nation ”.
Enfin, en prohibant le parti unique, l'article 3 jette les bases d'un pluralisme politique dont la double finalité est “ l'organisation et la représentation des citoyens ”.
Diverses décuctions sont alors possibles, favorisant l'hypothèse du “ pluralisme et de l'unanimitaire ” comme paramètres dont la combinaison participe du fond constitutionnel spécifique marocain. En effet, l'exercice par les institutions constitutionnelles de la souveraineté nationale suppose logiquement un lien entre élection et représentation et l'expression des suffrages par les partis politiques.
Or la constitution, en introduisant une hiérarchie dans la représentation nationale entre le Roi et le Parlement induit un pluralisme relativisé, réduisant de la sorte, les élections “ à désigner des représentants appelés à participer aux côtés du premier représentant de la nation, le roi à l'exercice de la souveraineté ”.
Il s'agira pour nous de tenter une lecture alternée ou contrastée de ces données, pour décrire leur possible articulation, souligner la fonction de légitimation qu'elles induisent. Notre réflexion portera sur le système représentatif marocain, dont les ressorts s'articulent autour d'un pluralisme circonscrit par une tendance unanimitaire incarnée.
Constituant un paramètre essentiel de la vie politique, le pluralisme au Maroc relève d'une catégorie complexe. “ Il est à la fois artificiel et inconsistant que réel et actif ”. La lecture dominante qui en est faite le définit comme produit d'une neutralisation – marginalisation du mouvement national, mettant ainsi à la périphérie de l'analyse l'argument du pluralisme social et d'autres variantes. Le type de représentation qu'il entraîne sur le triple plan partisan (A) parlementaire (B) et électoral (C) réduit le pluralisme à une variable dépendante, une valeur instrumentalisée.
La Constitution de 1962, selon une formule imuable “ garantit à tous les citoyens (…) la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix ”. Cette énonciation de principe formalise l'activité politique qu'elle place dans l'esprit libéral qui la fonde théoriquement. Le pluralisme qu'elle induit se trouve précisément défini par l'article 3 de la constitution qui, outre l'interdiction du parti unique précise dans sa rédaction initiale : “les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens ”.
Depuis 1970, les partis ont constitutionnellement perdu le monopole de cette fonction puisqu'ils “ concourent avec les syndicats, les collectivités locales et les chambres professionnelles à l'organisation et la représentation des citoyens ”. Diverses lectures sont alors possibles. D'une part, la nature de “ la représentation ” des citoyens demeure confuse du moment que la constitution n'en explicite pas le caractère présumé “ politique ”.
D'autre part, impliquant, une pluralité d'acteurs et d'institutions, le pluralisme ainsi décrit apparaît comme la somme d'agrégats divers. Ce phénomène d'agrégation ne semble pourtant pas suffisant à l'expression pluraliste. La clause ajoutée portant “ interdiction du parti unique ” dote apparemment le pluralisme affirmé d'une amplitude.
Mais à l'analyse, cette juxtaposition d'un principe “ le pluralisme ” et de son contraire “ le parti unique ” prohibé, introduit une appréciation réductrice du premier par l'effet du second. Le pluralisme n'est plus définit en soi, il se détermine par le refus du monopartisme. Autrement dit, c'est l'impossibilité d'adopter un système monopartisan qui préside au pluralisme politique mu alors en modèle de substitution. En définive, les partis politiques exercent une fonction représentative “ minorisée ” qui éclaire le statut de la représentation parlementaire.
A côté du Roi, représentant suprême de la Nation, le Parlement est le seul organe auquel celle-ci a confié par voie de suffrage le pouvoir de la représenter. Doté d'une légitimité démocratique, le Parlement assure une représentation plurielle des acteurs et institutions qui selon l'article 3 de la constitution “concourent à l'organisation et la représentation des citoyens”.
Pareille fragmentation, ajoutée à la structuration bicamérale et aux techniques du parlementarisme rationalisé confinent la représentation parlementaire dans un statut secondaire, un organe consulté sinon passablement délibératif. Aussi, relais destiné à mettre en forme, à amplifier et à diffuser la politique royale, le Parlement ne saurait être un centre de décision initiale et a fortiori, un centre de contestation de la politique du pouvoir. Cette approche de la représentation parlementaire influe sur le processus électoral.
Selon un point de vue logique et normatif, les élections concurrentielles pluralistes conformes au modèle occidental apparaissent généralement comme le critère de la démocratie. Celle-ci sous-tendue et impulsée par un niveau de développement économique et social parallèle donne aussi naissance au développement des partis comme appareil d'encadrement, de représentation, de production idéologique et d'expression des suffrages.
La consécration du pluralisme politique passe nécessairement par l'organisation d'élections concurrentielles, d'élections libres. L'observation empirique de la réalité électorale révèle une dichotomie entre les systèmes conformes à la logique et aux normes de la démocratie libérale où l'élection est synonyme de choix et l'électeur est un être rationnel c'est-à-dire doté d'un statut qui l'habilite à avoir ses raisons, et les systèmes non-concurrentiels, où l'élection est sans choix et l'électeur se réduit à un élément accessoire voire inexistant.
Depuis 1960, le processus électoral au Maroc a vu son évolution fondée sur un nombre de principes et de normes inspirés de la démocratie libérale, réglementant les différentes phases de son organisation et de son déroulement. Dès lors, que le centre monarchique se situe constitutionnellement dans un esprit de continuité en dehors de toute compétition et vu l'intensité politique qu'il génère, les garanties exigées et négociées, la participation qu'il entraîne et la contestation qui l'accompagne, le processus électoral parlementaire en l'occurrence finit à coups d'évolution par devenir un modèle aux allures concurrentielles.
Il reste cependant que la loi qui commande le processus est que les initiatives doivent être contrôlées par le sommet ou négociées avec lui. Cette mise sous tutelle entraîne une représentation résultat d'un pluralisme exclusionnaire, d'un contrôle clientéliste et d'une restriction du choix des électeurs par des pratiques disqualifiantes.
Le pluripartisme exclusionnaire est une formule grâce à laquelle le pouvoir expulse du jeu politique légal et spécialement du jeu électoral, les oppositions qu'il juge dangereuses ou gênantes pour le maintien de son hégémonie. Ce fut une pratique courante en Espagne franquiste et en Amérique Latine. Au Maroc, cette tendance s'était affirmée par la marginalisation – neutralisation de l'opposition au moyen d'une cooptation d'élites bureaucratiques ayant la bénédiction du pouvoir pour investir le marché électoral.
Le contrôle clientéliste :sous-entend les différentes modalités de domination sociale qui permettent de diriger impérativement les choix électoraux. Le vote n'est pas un choix d'opinion.
Il s'agit d'une valeur économique donnée à un droit politique, le clientélisme suppose une organisation de l'électorat pour le jour du scrutin (transport, hébergement, divertissement). Le suffrage n'est pas une participation politique exprimant l'opinion. Le résultat ne traduit pas des attitudes et des choix politiques.
En définitive, le pluralisme politique, ramené essentiellement au pluripartisme “pour autant qu'il existe n'est pas accusé”. Les pesanteurs monolithiques de la communauté fournissent un autre type d'explication. La représentation politique exprime diversement l'unanimitaire.
* Najib Ba Mohammed est vice-président de l'Association marocaine de Droit constitutionnel
Najib Ba Mohammed * |
C'est cette conception de la démocratie que retient la constitution marocaine de 1996, son article 2 proclamant que : “ La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles ”. Cette disposition renvoie implicitement à la notion de représentation nationale en vertu de laquelle la Nation exprime sa souveraineté par le truchement de ses représentants en l'occurrence le Roi et le Parlement. Ainsi de l'article 19 aux termes duquel : “ Le Roi, Amir Al Mouminine, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la constitition.
Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques ”. Tandis que l'article 36 précise que les membres du Parlement “ tiennent leur mandat de la Nation ”.
Enfin, en prohibant le parti unique, l'article 3 jette les bases d'un pluralisme politique dont la double finalité est “ l'organisation et la représentation des citoyens ”.
Diverses décuctions sont alors possibles, favorisant l'hypothèse du “ pluralisme et de l'unanimitaire ” comme paramètres dont la combinaison participe du fond constitutionnel spécifique marocain. En effet, l'exercice par les institutions constitutionnelles de la souveraineté nationale suppose logiquement un lien entre élection et représentation et l'expression des suffrages par les partis politiques.
Or la constitution, en introduisant une hiérarchie dans la représentation nationale entre le Roi et le Parlement induit un pluralisme relativisé, réduisant de la sorte, les élections “ à désigner des représentants appelés à participer aux côtés du premier représentant de la nation, le roi à l'exercice de la souveraineté ”.
Il s'agira pour nous de tenter une lecture alternée ou contrastée de ces données, pour décrire leur possible articulation, souligner la fonction de légitimation qu'elles induisent. Notre réflexion portera sur le système représentatif marocain, dont les ressorts s'articulent autour d'un pluralisme circonscrit par une tendance unanimitaire incarnée.
Constituant un paramètre essentiel de la vie politique, le pluralisme au Maroc relève d'une catégorie complexe. “ Il est à la fois artificiel et inconsistant que réel et actif ”. La lecture dominante qui en est faite le définit comme produit d'une neutralisation – marginalisation du mouvement national, mettant ainsi à la périphérie de l'analyse l'argument du pluralisme social et d'autres variantes. Le type de représentation qu'il entraîne sur le triple plan partisan (A) parlementaire (B) et électoral (C) réduit le pluralisme à une variable dépendante, une valeur instrumentalisée.
La Constitution de 1962, selon une formule imuable “ garantit à tous les citoyens (…) la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix ”. Cette énonciation de principe formalise l'activité politique qu'elle place dans l'esprit libéral qui la fonde théoriquement. Le pluralisme qu'elle induit se trouve précisément défini par l'article 3 de la constitution qui, outre l'interdiction du parti unique précise dans sa rédaction initiale : “les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens ”.
Depuis 1970, les partis ont constitutionnellement perdu le monopole de cette fonction puisqu'ils “ concourent avec les syndicats, les collectivités locales et les chambres professionnelles à l'organisation et la représentation des citoyens ”. Diverses lectures sont alors possibles. D'une part, la nature de “ la représentation ” des citoyens demeure confuse du moment que la constitution n'en explicite pas le caractère présumé “ politique ”.
D'autre part, impliquant, une pluralité d'acteurs et d'institutions, le pluralisme ainsi décrit apparaît comme la somme d'agrégats divers. Ce phénomène d'agrégation ne semble pourtant pas suffisant à l'expression pluraliste. La clause ajoutée portant “ interdiction du parti unique ” dote apparemment le pluralisme affirmé d'une amplitude.
Mais à l'analyse, cette juxtaposition d'un principe “ le pluralisme ” et de son contraire “ le parti unique ” prohibé, introduit une appréciation réductrice du premier par l'effet du second. Le pluralisme n'est plus définit en soi, il se détermine par le refus du monopartisme. Autrement dit, c'est l'impossibilité d'adopter un système monopartisan qui préside au pluralisme politique mu alors en modèle de substitution. En définive, les partis politiques exercent une fonction représentative “ minorisée ” qui éclaire le statut de la représentation parlementaire.
A côté du Roi, représentant suprême de la Nation, le Parlement est le seul organe auquel celle-ci a confié par voie de suffrage le pouvoir de la représenter. Doté d'une légitimité démocratique, le Parlement assure une représentation plurielle des acteurs et institutions qui selon l'article 3 de la constitution “concourent à l'organisation et la représentation des citoyens”.
Pareille fragmentation, ajoutée à la structuration bicamérale et aux techniques du parlementarisme rationalisé confinent la représentation parlementaire dans un statut secondaire, un organe consulté sinon passablement délibératif. Aussi, relais destiné à mettre en forme, à amplifier et à diffuser la politique royale, le Parlement ne saurait être un centre de décision initiale et a fortiori, un centre de contestation de la politique du pouvoir. Cette approche de la représentation parlementaire influe sur le processus électoral.
Selon un point de vue logique et normatif, les élections concurrentielles pluralistes conformes au modèle occidental apparaissent généralement comme le critère de la démocratie. Celle-ci sous-tendue et impulsée par un niveau de développement économique et social parallèle donne aussi naissance au développement des partis comme appareil d'encadrement, de représentation, de production idéologique et d'expression des suffrages.
La consécration du pluralisme politique passe nécessairement par l'organisation d'élections concurrentielles, d'élections libres. L'observation empirique de la réalité électorale révèle une dichotomie entre les systèmes conformes à la logique et aux normes de la démocratie libérale où l'élection est synonyme de choix et l'électeur est un être rationnel c'est-à-dire doté d'un statut qui l'habilite à avoir ses raisons, et les systèmes non-concurrentiels, où l'élection est sans choix et l'électeur se réduit à un élément accessoire voire inexistant.
Depuis 1960, le processus électoral au Maroc a vu son évolution fondée sur un nombre de principes et de normes inspirés de la démocratie libérale, réglementant les différentes phases de son organisation et de son déroulement. Dès lors, que le centre monarchique se situe constitutionnellement dans un esprit de continuité en dehors de toute compétition et vu l'intensité politique qu'il génère, les garanties exigées et négociées, la participation qu'il entraîne et la contestation qui l'accompagne, le processus électoral parlementaire en l'occurrence finit à coups d'évolution par devenir un modèle aux allures concurrentielles.
Il reste cependant que la loi qui commande le processus est que les initiatives doivent être contrôlées par le sommet ou négociées avec lui. Cette mise sous tutelle entraîne une représentation résultat d'un pluralisme exclusionnaire, d'un contrôle clientéliste et d'une restriction du choix des électeurs par des pratiques disqualifiantes.
Le pluripartisme exclusionnaire est une formule grâce à laquelle le pouvoir expulse du jeu politique légal et spécialement du jeu électoral, les oppositions qu'il juge dangereuses ou gênantes pour le maintien de son hégémonie. Ce fut une pratique courante en Espagne franquiste et en Amérique Latine. Au Maroc, cette tendance s'était affirmée par la marginalisation – neutralisation de l'opposition au moyen d'une cooptation d'élites bureaucratiques ayant la bénédiction du pouvoir pour investir le marché électoral.
Le contrôle clientéliste :sous-entend les différentes modalités de domination sociale qui permettent de diriger impérativement les choix électoraux. Le vote n'est pas un choix d'opinion.
Il s'agit d'une valeur économique donnée à un droit politique, le clientélisme suppose une organisation de l'électorat pour le jour du scrutin (transport, hébergement, divertissement). Le suffrage n'est pas une participation politique exprimant l'opinion. Le résultat ne traduit pas des attitudes et des choix politiques.
En définitive, le pluralisme politique, ramené essentiellement au pluripartisme “pour autant qu'il existe n'est pas accusé”. Les pesanteurs monolithiques de la communauté fournissent un autre type d'explication. La représentation politique exprime diversement l'unanimitaire.
* Najib Ba Mohammed est vice-président de l'Association marocaine de Droit constitutionnel
Najib Ba Mohammed * |