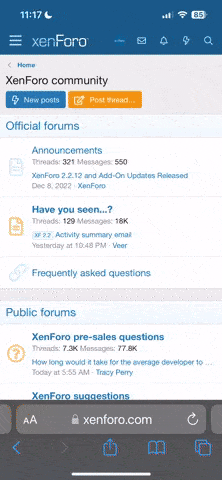LA LANGUE BERBERE AU SAHARA
par André Basset
Ce qu’il faut dire en premier lieu, c’est que le Sahara n’a pas d’unité linguistique et ne forme pas un tout inséparable des régions environnantes. Indépendamment de langues comme celle des Tebous, échelonnés du Fezzan au Tchad, de langues de populations noires comme le Kanouri parlé jusqu’au Kaouar ou le Haoussa qui remonte jusqu’à Agadès, deux langues essentiellement se le partagent : l’arabe et le berbère. Toutes deux sont en soi des langues de populations blanches. Nous savons pertinemment pour l’une, l’arabe, qu’elle y a été introduite depuis le XIIème siècle à la suite du prodigieux mouvement d’expansion ayant eu l’Arabie pour point de départ. Quant à l’autre, le berbère, elle devait, il y a quelque deux mille ans, s’avancer infiniment moins au sud qu’aujourd’hui. Elle a dû gagner progressivement aux dépens d’autres refoulées ou anéanties, non par expansion en tant qu’instrument d’une civilisation, non tant en vertu d’un dynamisme conquérant de ceux qui la parlaient, que de leur refoulement, contrecoup des événements politiques de l’Afrique méditerranéenne.
La présence du berbère, aujourd’hui encore, au nord-est jusqu’à Siwa, à la frontière égyptienne, au sud-ouest, jusqu’au Sénégal ou presque, chez les Zenaga, nous assure que l’expansion de l’arabe s’est faite, dans la majeure partie du Sahara au moins, aux dépens du berbère, soit que des groupements arabophones d’origine se soient implantés au milieu de groupements berbérophones, soit que, parmi ceux-ci, certains, au cours des âges, aient abandonné le berbère pour l’arabe comme ils continuent de le faire de nos jours. Et cela amène à reconnaître parmi les berbérophones deux catégories nettement distinctes suivant un critère de vitalité, lui même inséparable d’autres considérations.
Les groupements où le berbère peut être considéré comme résiduel, quel que soit, ici et là, son état effectif de résistance, ce sont_ en dehors des quelques milliers de Zenaga dèjà mentionnés, tout au sud de la Mauritanie, entre Mederdra et l’Océan_ les noyaux de sédentaires qui s’échelonnent dans la partie nord du Sahara de la frontière égyptienne à la frontière marocaine : en allant d’est en ouest, Siwa, en territoire égyptien, Aoudjila, au sud de la Cyrénaique, Sokna, si l’on veut, au nord du Fezzan ( où le berbère, bien précaire il y a vingt ans, est peut-être éteint aujourd’hui), Ghadamès, au sud de la Tunisie, cinq villages de l’Ouest Righ autour de Touggourt, Ouargla et Ngousa, les sept villes du Mzab où l’hétérodoxie ibadite peut contribuer à protéger la langue, la moitié environ des quelque 150 minuscules « ksours » du Gourara, un village du Tidikelt, Tit, deux du Touat, Tementit et Tittaf, enfin, de part et d’autre de la frontière algéro-marocaine, la presque totalité des agglomérations d’Igli à Chellala Dahrania, inclus, centrées sur Figuig. Au delà, jusqu’à l’Atlantique, dans la masse quasi continue des parlers marocains qui vont de la Méditerranée à la lisière du Sahara, il est difficile de faire, sur cette lisière le départ de ceux que l’on peut proprement qualifier de sahariens : aussi le négligerions nous.
En regard de cette première catégorie où le berbère est soit menacé, soit attaqué, soit presque éliminé par l’arabe, il en est une autre où la situation est bien différente : celle des Touaregs.
Nomades, enserrant de rares groupements sédentaires :Ghat, Djanet, ou même tendant parfois, en bordure des populations noires, nigrifiés,à se sédentariser, comme à Bonkoukou, à l’est de Niamey, dans la colonie du Niger, ils occupent un vaste triangle dont la pointe nord avoisine Ghadamès, la pointe sud-ouest dépasse Tombouctou et Goundam et la pointe sud-est Zinder.
Bien qu’ils soient musulmans et incontestablement musulmans, quoi qu’on ait pu en écrire, l’arabe n’a pratiquement pas pénétré chez eux sinon dans la mesure où certains apprennent scolairement quelques mots de la langue du Coran. D’autre part, forts de leur nomadisme même, strictement pasteurs, gardant à l’encontre des sédentaires arboriculteurs ou cultivateurs selon le cas, la plus grande aisance dans leurs mouvements, habitant pour partie un pays déshérité, véritable repaire, admirablement protégé sur presque toutes ses frontières par une zone de pur désert, forts également de leur hiérarchie sociale et de la primauté des nobles guerriers, harcelant leurs voisins , s’imposant aux ksouriens, s’infiltrant au Fezzan jusqu’aux abords des villages, ils ont eu jusqu’à ce jour un dynamisme tout à l’avantage de leur langue. Et si celle-ci ne débordait pas leur aire_ encore trouverait-on quelques témoignages d’influence au dehors comme dans le nom du chameau, si même, rencontrant au sud une flore et une faune nouvelles, elle se chargeait de termes empruntés à des langues noires, du moins elle s’imposait à la longue aux éléments étrangers qui pénétraient dans cette aire, aux esclaves noirs en particuliers, tandis que les Touaregs eux-mêmes, avec quelques réserves surtout pour le sud, n’éprouvant guère le besoin d’une langue auxiliaire pour des rapports de voisinage qui ne fussent pas à main armée, restaient, pratiquement, les hommes aussi bien que les femmes, berbérophones purs. Et si, aujourd’hui, la langue berbère peut sembler dans une situation précaire, même ici, chez quelques milliers d’individus, au cœur du sahara, du fait des perturbations, voire de la rupture d’équilibre vital provoquées par notre intervention et la pacification, au sud, par contre, grâce à l’état de prospérité où vivent en ce moment quelque 300.000 Touaregs, maîtres de vastes troupeaux, en des régions aux pâturages déjà abondants, régulièrement revivifiés par des pluies périodiques annuelles et impropres à tout autre genre de vie, elle paraît rencontrer des conditions d’existence sinon absolument identiques à celles des temps antérieurs , du moins également favorables.
Les manifestations sahariennes du berbère en sont les plus orientales et les plus méridionales, les autres intéressant la partie occidentale du Djebel Nefousa et Zouara, sur la côte, en Tripolitaine, 13 agglomérations du sud tunisien dont 6 dans l’île de Djerba, le tiers de la population musulmane de l’Algérie et près de la moitié de celle du Maroc.
On parle parfois d’une langue touarègue, soit qu’on ait conscience de son intégration au berbère, soit qu’on l’ignore ou l’oublie. Si, dans le deuxième cas, il y a erreur manifeste, dans le premier, il y a exagération. Les particularités du touareg ne sont pas si importantes, en effet, qu’il y ait lieu de le dissocier aussi fortement. Le fonds commun grammatical, pour nous en tenir à cet aspect essentiel, est si prédominant et si souvent absolument identique de bout en bout du domaine, qu’il n’y a jamais lieu de parler de plusieurs langues, mais d’une langue seulement.
Toutefois, si, malgré les divergences de genre de vie et de structure sociale, cette unité fondamentale a pu se maintenir si sensible jusqu’à nos jours, l’intense prédominance du particularisme d’unités minuscules de quelques milliers, ou même de quelques centaines d’individus, la quasi exclusivité de l’emploi de cet instrument de relations pour les rapports internes de chacun de ces petits groupes sociaux, tempérée cependant par ceux de proche voisinage, ont provoqué une fragmentation, voire un émiettement superficiel, sans que se soit instaurée de koinè passe-partout ou sans que l’un des parlers, se superposant aux autres, ait accédé au rang de langue de civilisation.
Pur fixer les modalités de cette dislocation, en saisir le cause particulière, nous sommes bien mal outillés et vraisemblablement des données historique suffisantes nous feront toujours défaut. Ce peuple de civilisation orale ne parait pas avoir une tradition, littéraire ou non, susceptible de nous contenter : point d’épopée, en particulier, historique ou peudo-historique, permettant de remonter dans un passé lointain ; les touaregs qui couvrent les rochers d’inscriptions, n’ont pas apparemment le sens de l’inscription commémorative, et nous restons, sur ce point, pour ainsi dire limités à ce que nous pouvons tirer d’auteurs anciens et surtout arabes. Quant à la base essentielle d’une pareille étude, l’examen des parlers eux même, il est trop tôt encore pour que nous puissions faire mieux que de mettre de-ci de-là un détail en évidence. Notre documentation est toujours bien fragmentaire et bien inégale. Pour nous en tenir à ce qui a été publié, elle en est restée parfois, ou presque, ainsi pour Aoudjila, aux brèves notes d’un voyageur inexpert de la période héroïque, pour les touaregs du fleuve aux centenaires de Barth, pour le sud oranais et l’oued Righ aux précieuse mais rapides enquête de René Basset, pour les Zenega aux ouvrages utiles mais à rajeunir de Faidherbe et de René Basset aussi, pour le Mzab, vrai pôle d’attraction, à une floraison d’études embryonnaires, et si la situation est un peu meilleure pour Ghadamès, grâce à Motylinski, surtout Ouargla grâce à Biarnay, et Siwa grâce à M. Louast, dont les étude sont plus récentes et plus conséquentes, nous ne disposons vraiment d’une documentation pleinement satisfaisante par sa richesse et sa qualité que pour le Kel Ahaggar grâce au Père de Foucault. Il et vrai que nous attendons de M. Nicolas un nouveau travail sur le Zenaga et une riche moisson de faits pour les Touaregs Ioulemmeden de Tahoua.
par André Basset
Ce qu’il faut dire en premier lieu, c’est que le Sahara n’a pas d’unité linguistique et ne forme pas un tout inséparable des régions environnantes. Indépendamment de langues comme celle des Tebous, échelonnés du Fezzan au Tchad, de langues de populations noires comme le Kanouri parlé jusqu’au Kaouar ou le Haoussa qui remonte jusqu’à Agadès, deux langues essentiellement se le partagent : l’arabe et le berbère. Toutes deux sont en soi des langues de populations blanches. Nous savons pertinemment pour l’une, l’arabe, qu’elle y a été introduite depuis le XIIème siècle à la suite du prodigieux mouvement d’expansion ayant eu l’Arabie pour point de départ. Quant à l’autre, le berbère, elle devait, il y a quelque deux mille ans, s’avancer infiniment moins au sud qu’aujourd’hui. Elle a dû gagner progressivement aux dépens d’autres refoulées ou anéanties, non par expansion en tant qu’instrument d’une civilisation, non tant en vertu d’un dynamisme conquérant de ceux qui la parlaient, que de leur refoulement, contrecoup des événements politiques de l’Afrique méditerranéenne.
La présence du berbère, aujourd’hui encore, au nord-est jusqu’à Siwa, à la frontière égyptienne, au sud-ouest, jusqu’au Sénégal ou presque, chez les Zenaga, nous assure que l’expansion de l’arabe s’est faite, dans la majeure partie du Sahara au moins, aux dépens du berbère, soit que des groupements arabophones d’origine se soient implantés au milieu de groupements berbérophones, soit que, parmi ceux-ci, certains, au cours des âges, aient abandonné le berbère pour l’arabe comme ils continuent de le faire de nos jours. Et cela amène à reconnaître parmi les berbérophones deux catégories nettement distinctes suivant un critère de vitalité, lui même inséparable d’autres considérations.
Les groupements où le berbère peut être considéré comme résiduel, quel que soit, ici et là, son état effectif de résistance, ce sont_ en dehors des quelques milliers de Zenaga dèjà mentionnés, tout au sud de la Mauritanie, entre Mederdra et l’Océan_ les noyaux de sédentaires qui s’échelonnent dans la partie nord du Sahara de la frontière égyptienne à la frontière marocaine : en allant d’est en ouest, Siwa, en territoire égyptien, Aoudjila, au sud de la Cyrénaique, Sokna, si l’on veut, au nord du Fezzan ( où le berbère, bien précaire il y a vingt ans, est peut-être éteint aujourd’hui), Ghadamès, au sud de la Tunisie, cinq villages de l’Ouest Righ autour de Touggourt, Ouargla et Ngousa, les sept villes du Mzab où l’hétérodoxie ibadite peut contribuer à protéger la langue, la moitié environ des quelque 150 minuscules « ksours » du Gourara, un village du Tidikelt, Tit, deux du Touat, Tementit et Tittaf, enfin, de part et d’autre de la frontière algéro-marocaine, la presque totalité des agglomérations d’Igli à Chellala Dahrania, inclus, centrées sur Figuig. Au delà, jusqu’à l’Atlantique, dans la masse quasi continue des parlers marocains qui vont de la Méditerranée à la lisière du Sahara, il est difficile de faire, sur cette lisière le départ de ceux que l’on peut proprement qualifier de sahariens : aussi le négligerions nous.
En regard de cette première catégorie où le berbère est soit menacé, soit attaqué, soit presque éliminé par l’arabe, il en est une autre où la situation est bien différente : celle des Touaregs.
Nomades, enserrant de rares groupements sédentaires :Ghat, Djanet, ou même tendant parfois, en bordure des populations noires, nigrifiés,à se sédentariser, comme à Bonkoukou, à l’est de Niamey, dans la colonie du Niger, ils occupent un vaste triangle dont la pointe nord avoisine Ghadamès, la pointe sud-ouest dépasse Tombouctou et Goundam et la pointe sud-est Zinder.
Bien qu’ils soient musulmans et incontestablement musulmans, quoi qu’on ait pu en écrire, l’arabe n’a pratiquement pas pénétré chez eux sinon dans la mesure où certains apprennent scolairement quelques mots de la langue du Coran. D’autre part, forts de leur nomadisme même, strictement pasteurs, gardant à l’encontre des sédentaires arboriculteurs ou cultivateurs selon le cas, la plus grande aisance dans leurs mouvements, habitant pour partie un pays déshérité, véritable repaire, admirablement protégé sur presque toutes ses frontières par une zone de pur désert, forts également de leur hiérarchie sociale et de la primauté des nobles guerriers, harcelant leurs voisins , s’imposant aux ksouriens, s’infiltrant au Fezzan jusqu’aux abords des villages, ils ont eu jusqu’à ce jour un dynamisme tout à l’avantage de leur langue. Et si celle-ci ne débordait pas leur aire_ encore trouverait-on quelques témoignages d’influence au dehors comme dans le nom du chameau, si même, rencontrant au sud une flore et une faune nouvelles, elle se chargeait de termes empruntés à des langues noires, du moins elle s’imposait à la longue aux éléments étrangers qui pénétraient dans cette aire, aux esclaves noirs en particuliers, tandis que les Touaregs eux-mêmes, avec quelques réserves surtout pour le sud, n’éprouvant guère le besoin d’une langue auxiliaire pour des rapports de voisinage qui ne fussent pas à main armée, restaient, pratiquement, les hommes aussi bien que les femmes, berbérophones purs. Et si, aujourd’hui, la langue berbère peut sembler dans une situation précaire, même ici, chez quelques milliers d’individus, au cœur du sahara, du fait des perturbations, voire de la rupture d’équilibre vital provoquées par notre intervention et la pacification, au sud, par contre, grâce à l’état de prospérité où vivent en ce moment quelque 300.000 Touaregs, maîtres de vastes troupeaux, en des régions aux pâturages déjà abondants, régulièrement revivifiés par des pluies périodiques annuelles et impropres à tout autre genre de vie, elle paraît rencontrer des conditions d’existence sinon absolument identiques à celles des temps antérieurs , du moins également favorables.
Les manifestations sahariennes du berbère en sont les plus orientales et les plus méridionales, les autres intéressant la partie occidentale du Djebel Nefousa et Zouara, sur la côte, en Tripolitaine, 13 agglomérations du sud tunisien dont 6 dans l’île de Djerba, le tiers de la population musulmane de l’Algérie et près de la moitié de celle du Maroc.
On parle parfois d’une langue touarègue, soit qu’on ait conscience de son intégration au berbère, soit qu’on l’ignore ou l’oublie. Si, dans le deuxième cas, il y a erreur manifeste, dans le premier, il y a exagération. Les particularités du touareg ne sont pas si importantes, en effet, qu’il y ait lieu de le dissocier aussi fortement. Le fonds commun grammatical, pour nous en tenir à cet aspect essentiel, est si prédominant et si souvent absolument identique de bout en bout du domaine, qu’il n’y a jamais lieu de parler de plusieurs langues, mais d’une langue seulement.
Toutefois, si, malgré les divergences de genre de vie et de structure sociale, cette unité fondamentale a pu se maintenir si sensible jusqu’à nos jours, l’intense prédominance du particularisme d’unités minuscules de quelques milliers, ou même de quelques centaines d’individus, la quasi exclusivité de l’emploi de cet instrument de relations pour les rapports internes de chacun de ces petits groupes sociaux, tempérée cependant par ceux de proche voisinage, ont provoqué une fragmentation, voire un émiettement superficiel, sans que se soit instaurée de koinè passe-partout ou sans que l’un des parlers, se superposant aux autres, ait accédé au rang de langue de civilisation.
Pur fixer les modalités de cette dislocation, en saisir le cause particulière, nous sommes bien mal outillés et vraisemblablement des données historique suffisantes nous feront toujours défaut. Ce peuple de civilisation orale ne parait pas avoir une tradition, littéraire ou non, susceptible de nous contenter : point d’épopée, en particulier, historique ou peudo-historique, permettant de remonter dans un passé lointain ; les touaregs qui couvrent les rochers d’inscriptions, n’ont pas apparemment le sens de l’inscription commémorative, et nous restons, sur ce point, pour ainsi dire limités à ce que nous pouvons tirer d’auteurs anciens et surtout arabes. Quant à la base essentielle d’une pareille étude, l’examen des parlers eux même, il est trop tôt encore pour que nous puissions faire mieux que de mettre de-ci de-là un détail en évidence. Notre documentation est toujours bien fragmentaire et bien inégale. Pour nous en tenir à ce qui a été publié, elle en est restée parfois, ou presque, ainsi pour Aoudjila, aux brèves notes d’un voyageur inexpert de la période héroïque, pour les touaregs du fleuve aux centenaires de Barth, pour le sud oranais et l’oued Righ aux précieuse mais rapides enquête de René Basset, pour les Zenega aux ouvrages utiles mais à rajeunir de Faidherbe et de René Basset aussi, pour le Mzab, vrai pôle d’attraction, à une floraison d’études embryonnaires, et si la situation est un peu meilleure pour Ghadamès, grâce à Motylinski, surtout Ouargla grâce à Biarnay, et Siwa grâce à M. Louast, dont les étude sont plus récentes et plus conséquentes, nous ne disposons vraiment d’une documentation pleinement satisfaisante par sa richesse et sa qualité que pour le Kel Ahaggar grâce au Père de Foucault. Il et vrai que nous attendons de M. Nicolas un nouveau travail sur le Zenaga et une riche moisson de faits pour les Touaregs Ioulemmeden de Tahoua.