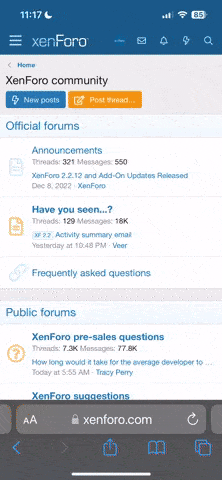Entretien avec Ahmed Arhmouch
«Le Réseau amazigh pour la citoyenneté préoccupé par la question constitutionnelle»
Le président du bureau exécutif du Réseau amazigh pour la citoyenneté, Ahmed Arhmouch, avocat de profession et fervent défenseur du dossier amazigh, stigmatise le bilan des réalisations accomplies jusqu’à nos jours en la matière, tout en relevant
les lacunes compromettant la conception du projet en cours de la promotion de la langue
et la culture amazighes.
Libération : Annoncé en 2001 en grande pompe, à Ajdir, où en est-on aujourd’hui, en général, avec le projet amazigh?
Ahmed Arhmouch : Je peux dire qu’on est au point de départ. Le bilan est médiocre, surtout que l’institutionnalisation de l’amazigh ne s’est pas faite d’une manière à même de réussir sérieusement sa vraie promotion. D’abord, le mouvement amazigh et en particulier les associations amazighes indépendantes, avait déjà signifié son rejet de la conception du dahir qui a permis la création de l’IRCAM. Nous avons considéré l’Institut comme un simple organisme de façade, un bébé né handicapé. C’est ce qui a été effectivement confirmé durant les quatre dernières années d’exercice de l’Institut. En plus, il s’est avéré que l’équipe politique dirigeant l’institut manque, dans sa majorité, de l’expérience professionnelle requise pour la gestion des affaires amazighes. C’est le cas de la gestion de la coopération et du partenariat avec les associations amazighes. C’est ce qui a conduit plusieurs associations amazighes à publier des communiqués refusant d’engager des partenariats avec l’IRCAM, estimant que l’institutionnalisation de la question amazighe doit se faire de manière rationnelle par le biais d’une institution autonome et transparente permettant de rendre des comptes. Et c'est ce qui a poussé le Réseau amazigh pour la citoyenneté à lancer une proposition institutionnelle alternative pour la réforme de l’IRCAM. Du coup, l’Institut n’est pas considéré, jusqu’à présent, comme un interlocuteur du mouvement associatif amazigh. Et ce, bien qu’il ait pris de grandes décisions que nous estimons, au contraire, avoir occasionné de graves conséquences sur l’avenir de la langue amazighe. Chose qui a été dénoncée par les associations concernées qui ont appelé à se rendre compte de la gravité des décisions prises dont certaines risquent d’aboutir à la création d’entités linguistiques amazighes antagonistes.
Arrêtons-nous sur l’un des principaux chantiers de la promotion du tamazight, c’est son enseignement dans les écoles publiques. Nous en sommes présentement à sa quatrième année. Quelle évaluation faites-vous des efforts consentis jusque-là en la matière?
Je pense que nous devons commencer par débattre de la base. Le Réseau amazigh pour la citoyenneté et les acteurs amazighs indépendants sont, au préalable, essentiellement préoccupés par la question constitutionnelle. Certes, les blocages faits par le gouvernement sont pour beaucoup dans le torpillage du projet de l’enseignement du tamazight. Mais, n’empêche, nous estimons devoir militer pour l’officialisation de la langue amazighe comme langue reconnue par la Constitution. Pour le moment, nous constatons une régression dangereuse dans le projet de son insertion à l’école publique. Il faut savoir que jusqu’alors, elle n’est pas enseignée dans les CE3 et CE4 d’aucune école du Royaume. Le constat est loin de refléter les stastiques annoncées par l’Institut. Par ailleurs, même ce qui est enseigné comme langue amazighe n’est, en fait, que des dialectes, alors que c’est la langue amazighe unifiée qu’il est convenu d’enseigner.
Le champ berbère connaît actuellement une grande effervescence, due à la contestation de la faible répercussion des médias audiovisuels publics de la diversité culturelle et languistique, de l’identité amazighe et donc d’un grand pan de notre société. D’où viennent les résistances qui entravent cet autre chantier?
Les résistances, selon mon point de vue, ont une triple origine : la première c'est l'absence d'une reconnaissance officielle du tamazight au niveau de la constitution ; la deuxième se base sur les orientations idéologiques de certains partis gouvernementaux qui sont en train de mettre en œuvre une politique anti-amazighe; et la troisième a trait à la faiblesse du rendement de l'IRCAM.
Certains membres de l’IRCAM font partie d’une commission créée pour la défense de l’amazigh à l’audiovisuel. Est-ce là un signe qui trahit l’échec de l’Institut à contraindre ses contractants à mettre en œuvre les dispositions prises dans ce domaine, ou cela dénote, tout simplement, d’une liberté d’opinion et d’action au sein de cette instance souvent accusée d’être un outil de récupération du dossier?
La lecture de cette initiative montre qu’il y a bien manquement aux conventions liant le gouvernement et l'Institut Royal de la culture amazighe dans le secteur des médias. Cela laisse penser à l’existence d’une politique gouvernementale négligeant les revendications du mouvement associatif amazigh. Mais il ne faut pas oublier non plus qu’une grande partie des associations amazighes démocratiques et autonomes a rejeté publiquement les conventions établies entre les départements gouvernementaux et l’IRCAM concernant l’intégration du dialecte amazigh dans le secteur médiatique et de l’enseignement. La commission que vous avez évoquée a évité de mentionner l’origine des entraves en question et s’est contentée de citer uniquement les conséquences de ces difficultés.
Les origines de ces obstacles résident dans le fait que l’IRCAM, vu la nature de sa création et le mode de son fonctionnement, ne peut pas faire plus que ce qu’il a réalisé jusqu’à présent. Car, le fond du problème est lié essentiellement au dahir relatif à la création et à l’organisation de l’IRCAM qui limite ses attributions et réduit ses pouvoirs d’action tout en compromettant son autonomie aux niveaux administratif et financier. L’IRCAM est considéré comme une simple institution consultative qui n’a pas de pouvoir politique lui permettant d’adopter un programme d’action. Il ne dispose pas, partant, d’outils d’ordre politique parallèles à ceux du gouvernement. Du coup, à mon avis, la question de l’institutionnalisation de l’amazighité, plus que jamais, est encore posée et l'initiative dont vous parlez ne fait que le réaffirmer.
Des acquis indéniables ont été obtenus au profit du dossier amazigh. Et vous, de par vos prises de position radicale, on vous attribue souvent le qualificatif de nihiliste. Vous vous plaisez dans cette attitude par contestation gratuite ou
objective?
C'est tout à fait normal que le Réseau amazigh pour la citoyenneté dérange quelques personnes ou certains organes; et c'est tout à fait logique d'entendre quelque jugement de nos positions, comme celui que vous avez cité dans votre question. Mais, est-ce là une position contestataire gratuite ou objective? Je vous réponds d’emblée que c’est une contestation objective et impartiale. Et je réitère que nous avons toujours la dignité et le courage politique de déclarer que malgré les avancées réalisées au cours des deux dernières décennies, il est incontestable, aujourd’hui, que le mouvement culturel amazigh traverse une phase de stagnation.
Entretien réalisé par IDRISS OUCHAGOUR
source:liberation
\
«Le Réseau amazigh pour la citoyenneté préoccupé par la question constitutionnelle»
Le président du bureau exécutif du Réseau amazigh pour la citoyenneté, Ahmed Arhmouch, avocat de profession et fervent défenseur du dossier amazigh, stigmatise le bilan des réalisations accomplies jusqu’à nos jours en la matière, tout en relevant
les lacunes compromettant la conception du projet en cours de la promotion de la langue
et la culture amazighes.
Libération : Annoncé en 2001 en grande pompe, à Ajdir, où en est-on aujourd’hui, en général, avec le projet amazigh?
Ahmed Arhmouch : Je peux dire qu’on est au point de départ. Le bilan est médiocre, surtout que l’institutionnalisation de l’amazigh ne s’est pas faite d’une manière à même de réussir sérieusement sa vraie promotion. D’abord, le mouvement amazigh et en particulier les associations amazighes indépendantes, avait déjà signifié son rejet de la conception du dahir qui a permis la création de l’IRCAM. Nous avons considéré l’Institut comme un simple organisme de façade, un bébé né handicapé. C’est ce qui a été effectivement confirmé durant les quatre dernières années d’exercice de l’Institut. En plus, il s’est avéré que l’équipe politique dirigeant l’institut manque, dans sa majorité, de l’expérience professionnelle requise pour la gestion des affaires amazighes. C’est le cas de la gestion de la coopération et du partenariat avec les associations amazighes. C’est ce qui a conduit plusieurs associations amazighes à publier des communiqués refusant d’engager des partenariats avec l’IRCAM, estimant que l’institutionnalisation de la question amazighe doit se faire de manière rationnelle par le biais d’une institution autonome et transparente permettant de rendre des comptes. Et c'est ce qui a poussé le Réseau amazigh pour la citoyenneté à lancer une proposition institutionnelle alternative pour la réforme de l’IRCAM. Du coup, l’Institut n’est pas considéré, jusqu’à présent, comme un interlocuteur du mouvement associatif amazigh. Et ce, bien qu’il ait pris de grandes décisions que nous estimons, au contraire, avoir occasionné de graves conséquences sur l’avenir de la langue amazighe. Chose qui a été dénoncée par les associations concernées qui ont appelé à se rendre compte de la gravité des décisions prises dont certaines risquent d’aboutir à la création d’entités linguistiques amazighes antagonistes.
Arrêtons-nous sur l’un des principaux chantiers de la promotion du tamazight, c’est son enseignement dans les écoles publiques. Nous en sommes présentement à sa quatrième année. Quelle évaluation faites-vous des efforts consentis jusque-là en la matière?
Je pense que nous devons commencer par débattre de la base. Le Réseau amazigh pour la citoyenneté et les acteurs amazighs indépendants sont, au préalable, essentiellement préoccupés par la question constitutionnelle. Certes, les blocages faits par le gouvernement sont pour beaucoup dans le torpillage du projet de l’enseignement du tamazight. Mais, n’empêche, nous estimons devoir militer pour l’officialisation de la langue amazighe comme langue reconnue par la Constitution. Pour le moment, nous constatons une régression dangereuse dans le projet de son insertion à l’école publique. Il faut savoir que jusqu’alors, elle n’est pas enseignée dans les CE3 et CE4 d’aucune école du Royaume. Le constat est loin de refléter les stastiques annoncées par l’Institut. Par ailleurs, même ce qui est enseigné comme langue amazighe n’est, en fait, que des dialectes, alors que c’est la langue amazighe unifiée qu’il est convenu d’enseigner.
Le champ berbère connaît actuellement une grande effervescence, due à la contestation de la faible répercussion des médias audiovisuels publics de la diversité culturelle et languistique, de l’identité amazighe et donc d’un grand pan de notre société. D’où viennent les résistances qui entravent cet autre chantier?
Les résistances, selon mon point de vue, ont une triple origine : la première c'est l'absence d'une reconnaissance officielle du tamazight au niveau de la constitution ; la deuxième se base sur les orientations idéologiques de certains partis gouvernementaux qui sont en train de mettre en œuvre une politique anti-amazighe; et la troisième a trait à la faiblesse du rendement de l'IRCAM.
Certains membres de l’IRCAM font partie d’une commission créée pour la défense de l’amazigh à l’audiovisuel. Est-ce là un signe qui trahit l’échec de l’Institut à contraindre ses contractants à mettre en œuvre les dispositions prises dans ce domaine, ou cela dénote, tout simplement, d’une liberté d’opinion et d’action au sein de cette instance souvent accusée d’être un outil de récupération du dossier?
La lecture de cette initiative montre qu’il y a bien manquement aux conventions liant le gouvernement et l'Institut Royal de la culture amazighe dans le secteur des médias. Cela laisse penser à l’existence d’une politique gouvernementale négligeant les revendications du mouvement associatif amazigh. Mais il ne faut pas oublier non plus qu’une grande partie des associations amazighes démocratiques et autonomes a rejeté publiquement les conventions établies entre les départements gouvernementaux et l’IRCAM concernant l’intégration du dialecte amazigh dans le secteur médiatique et de l’enseignement. La commission que vous avez évoquée a évité de mentionner l’origine des entraves en question et s’est contentée de citer uniquement les conséquences de ces difficultés.
Les origines de ces obstacles résident dans le fait que l’IRCAM, vu la nature de sa création et le mode de son fonctionnement, ne peut pas faire plus que ce qu’il a réalisé jusqu’à présent. Car, le fond du problème est lié essentiellement au dahir relatif à la création et à l’organisation de l’IRCAM qui limite ses attributions et réduit ses pouvoirs d’action tout en compromettant son autonomie aux niveaux administratif et financier. L’IRCAM est considéré comme une simple institution consultative qui n’a pas de pouvoir politique lui permettant d’adopter un programme d’action. Il ne dispose pas, partant, d’outils d’ordre politique parallèles à ceux du gouvernement. Du coup, à mon avis, la question de l’institutionnalisation de l’amazighité, plus que jamais, est encore posée et l'initiative dont vous parlez ne fait que le réaffirmer.
Des acquis indéniables ont été obtenus au profit du dossier amazigh. Et vous, de par vos prises de position radicale, on vous attribue souvent le qualificatif de nihiliste. Vous vous plaisez dans cette attitude par contestation gratuite ou
objective?
C'est tout à fait normal que le Réseau amazigh pour la citoyenneté dérange quelques personnes ou certains organes; et c'est tout à fait logique d'entendre quelque jugement de nos positions, comme celui que vous avez cité dans votre question. Mais, est-ce là une position contestataire gratuite ou objective? Je vous réponds d’emblée que c’est une contestation objective et impartiale. Et je réitère que nous avons toujours la dignité et le courage politique de déclarer que malgré les avancées réalisées au cours des deux dernières décennies, il est incontestable, aujourd’hui, que le mouvement culturel amazigh traverse une phase de stagnation.
Entretien réalisé par IDRISS OUCHAGOUR
source:liberation
\