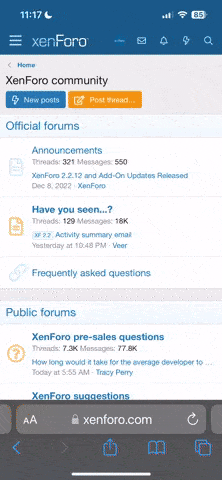Slam n Ṛebbi fell-awen ,
L’auteur : Lechani Mohand Saïd est originaire d ‘Irjen en Kabylie occidentale. Décédé en 1985 à l’age de 93 ans, il fut l’élève de Boulifa à l’ Ecole normale de Bouzariεa- Alger – ( promotion de 1912) avec qui il s’est lié d’amitié. Défenseur de la langue Amaziγ, il obtient , lors d’un séjours au Maroc (vers 1919),où il suit l ’enseignement d’ Emile Laoust , le certificat du berbère marocain . Il est également titulaire ,en 1948, du Diplôme de la langue berbère de la Faculté d ’Alger.
Homme pieux , militant de gauche (membre de la SFIO), rejoint le GPRA ( Gouvernement provisoire de la République Algérienne) en 1956 suite à un appel du FLN. At yerḥem Ṛebbi.
( Synthèse d’après un article de Salem Chaker paru dans Hommes et Femmes de kabylie Tome1)
Le vocabulaire kabyle est suffisamment riche pour permettre l'expression de la pensée et des sentiments avec nuance et précision. Il faut entendre les vieux montagnards de chez nous - ceux en particulier qui ne se sont jamais expatriés ou qui ne s'absentent que rarement du pays - pour se rendre compte de la richesse de notre langue, de son élégance remarquable, de la souplesse de sa syntaxe, de la variété de ses formes, de la sagesse et de la poésie de ses expressions. Mais seule une longue pratique et un usage constant permettent d'en saisir les finesses et le génie, d'en goûter l'esprit. Ceux qui n'ont pas suivi les réunions de djemaa, qui n'ont pas souvent assisté aux rencontres où se règlent les différends, aux conciliabules où se tranchent les affaires de famille, d'intérêt ou d'honneur, ne peuvent se faire une idée de la qualité des ressources verbales qu'elle met à la disposition des hommes qui participent aux discussions. Les séances de cette nature où s'affrontent des orateurs de classe, maîtres de leur langue et de leur pensée, constituent un véritable régal qui charme l'oreille et contente l'esprit. [...] Je suis Kabyle des Irjen. Je connais le dialecte zouaoua qui est ma langue maternelle que j'ai pratiquée et que je continue à pratiquer.
Pourtant le sens précis de bien des mots que j'emploie couramment et à bon escient m'échappe. Ce n'est qu'après un séjour prolongé au Maroc où j'ai eu l'occasion de me mettre en contact avec les Chleuhs et les Imaziγen que je suis arrivé à saisir convenablement le sens de beaucoup de vocables appartenant au vocabulaire de mon propre dialecte. C'est ainsi que j'ai pu noter un grand nombre de mots marocains qui m'ont permis de préciser mes connaissances en dialecte zouaoua. - Des exemples? Je peux en citer par dizaines. Le mot taγrut, par exemple, plur. tiγerdin est resté longtemps brumeux pour moi. Le sens de l'expression iγir deg γir (« bras dessus-bras dessous ») est demeuré aussi sans signification précise. Mais quand, au Maroc, j'ai appris qu'iγir signifie « épaule », l'expression iγir deg γir de chez nous et le mot taγrut ont vu leur sens se préciser. J'ai souvent entendu employer en Kabylie l'expression afqir n Sidna Σemmar, sans jamais saisir le sens de afqir. Or, au Maroc, ce mot signifie « vieillard » dans le Moyen-Atlas et « adepte » au Talifalet. Je comprends maintenant l'expression ci-dessus de chez nous (« adepte de la confrérie de Sidi Ammar »).
En zouaoua le tamis s'appelle aγerbal, mais il est une varité, de tamis fait de tiges d'alfa qui sert à tamiser fin la farine de blé et qu'on nomme tallumt. D'où peut bien venir ce mot? [...]. Mais quand on le retrouve au Maroc avec une très légère modification et un sens semblable ou légèrement différent : tallunt ou tallun qui signifient « crible » chez les Zemmour et «tambourin» ailleurs, on comprend alors le tallumt kabyle.
Il en est ainsi de bien d'autres mots. Le awtem, pl. iwetmen, diminutif tawtemt, pl. tiwetmin de chez nous (« testicule »), se retrouve au Maroc avec le sens de « mâle » (awtem), « femelle » (tawtemt). Certains berbérisants marocains l'emploient même en grammaire pour exprimer le masculin et le féminin. On comprend dès lors qu'awtem puisse chez nous signifier « testicule », cet attribut du mâle.
Snefḍas : en zouaoua : « plier, faire un pli ». En décomposant le mot, on s'aperçoit vite qu'il est à la forme à sifflante du verbe nnefḍas qui lui-même est une forme passive du verbe fdes dont le sens précis est oublié. On retrouve aux Aït Izdeg le même mot, avec une interversion de lettres, dfes, qui signifie « plier ». Voilà le mystère éclairci. Le mot ansi : « d'où? » ansi i d kkid? « D'où viens-tu? » apparaît avec un sens clair lorsqu'on sait qu'aux Aït Izdeg ansi signifie « endroit » - Ansi i d kkid = « De quel endroit viens-tu? ». Et il en est ainsi de tous les mots qui suivent, tous connus en Kabylie et dont le sens s'éclaire quand on les rapproche des mots berbères employés dans différents dialectes marocains. [Suit une liste d'une cinquantaine de mots kabyles obscurs rapprochés de termes marocains.]
L’auteur : Lechani Mohand Saïd est originaire d ‘Irjen en Kabylie occidentale. Décédé en 1985 à l’age de 93 ans, il fut l’élève de Boulifa à l’ Ecole normale de Bouzariεa- Alger – ( promotion de 1912) avec qui il s’est lié d’amitié. Défenseur de la langue Amaziγ, il obtient , lors d’un séjours au Maroc (vers 1919),où il suit l ’enseignement d’ Emile Laoust , le certificat du berbère marocain . Il est également titulaire ,en 1948, du Diplôme de la langue berbère de la Faculté d ’Alger.
Homme pieux , militant de gauche (membre de la SFIO), rejoint le GPRA ( Gouvernement provisoire de la République Algérienne) en 1956 suite à un appel du FLN. At yerḥem Ṛebbi.
( Synthèse d’après un article de Salem Chaker paru dans Hommes et Femmes de kabylie Tome1)
Considérations sur la langue berbère
Le vocabulaire kabyle est suffisamment riche pour permettre l'expression de la pensée et des sentiments avec nuance et précision. Il faut entendre les vieux montagnards de chez nous - ceux en particulier qui ne se sont jamais expatriés ou qui ne s'absentent que rarement du pays - pour se rendre compte de la richesse de notre langue, de son élégance remarquable, de la souplesse de sa syntaxe, de la variété de ses formes, de la sagesse et de la poésie de ses expressions. Mais seule une longue pratique et un usage constant permettent d'en saisir les finesses et le génie, d'en goûter l'esprit. Ceux qui n'ont pas suivi les réunions de djemaa, qui n'ont pas souvent assisté aux rencontres où se règlent les différends, aux conciliabules où se tranchent les affaires de famille, d'intérêt ou d'honneur, ne peuvent se faire une idée de la qualité des ressources verbales qu'elle met à la disposition des hommes qui participent aux discussions. Les séances de cette nature où s'affrontent des orateurs de classe, maîtres de leur langue et de leur pensée, constituent un véritable régal qui charme l'oreille et contente l'esprit. [...] Je suis Kabyle des Irjen. Je connais le dialecte zouaoua qui est ma langue maternelle que j'ai pratiquée et que je continue à pratiquer.
Pourtant le sens précis de bien des mots que j'emploie couramment et à bon escient m'échappe. Ce n'est qu'après un séjour prolongé au Maroc où j'ai eu l'occasion de me mettre en contact avec les Chleuhs et les Imaziγen que je suis arrivé à saisir convenablement le sens de beaucoup de vocables appartenant au vocabulaire de mon propre dialecte. C'est ainsi que j'ai pu noter un grand nombre de mots marocains qui m'ont permis de préciser mes connaissances en dialecte zouaoua. - Des exemples? Je peux en citer par dizaines. Le mot taγrut, par exemple, plur. tiγerdin est resté longtemps brumeux pour moi. Le sens de l'expression iγir deg γir (« bras dessus-bras dessous ») est demeuré aussi sans signification précise. Mais quand, au Maroc, j'ai appris qu'iγir signifie « épaule », l'expression iγir deg γir de chez nous et le mot taγrut ont vu leur sens se préciser. J'ai souvent entendu employer en Kabylie l'expression afqir n Sidna Σemmar, sans jamais saisir le sens de afqir. Or, au Maroc, ce mot signifie « vieillard » dans le Moyen-Atlas et « adepte » au Talifalet. Je comprends maintenant l'expression ci-dessus de chez nous (« adepte de la confrérie de Sidi Ammar »).
En zouaoua le tamis s'appelle aγerbal, mais il est une varité, de tamis fait de tiges d'alfa qui sert à tamiser fin la farine de blé et qu'on nomme tallumt. D'où peut bien venir ce mot? [...]. Mais quand on le retrouve au Maroc avec une très légère modification et un sens semblable ou légèrement différent : tallunt ou tallun qui signifient « crible » chez les Zemmour et «tambourin» ailleurs, on comprend alors le tallumt kabyle.
Il en est ainsi de bien d'autres mots. Le awtem, pl. iwetmen, diminutif tawtemt, pl. tiwetmin de chez nous (« testicule »), se retrouve au Maroc avec le sens de « mâle » (awtem), « femelle » (tawtemt). Certains berbérisants marocains l'emploient même en grammaire pour exprimer le masculin et le féminin. On comprend dès lors qu'awtem puisse chez nous signifier « testicule », cet attribut du mâle.
Snefḍas : en zouaoua : « plier, faire un pli ». En décomposant le mot, on s'aperçoit vite qu'il est à la forme à sifflante du verbe nnefḍas qui lui-même est une forme passive du verbe fdes dont le sens précis est oublié. On retrouve aux Aït Izdeg le même mot, avec une interversion de lettres, dfes, qui signifie « plier ». Voilà le mystère éclairci. Le mot ansi : « d'où? » ansi i d kkid? « D'où viens-tu? » apparaît avec un sens clair lorsqu'on sait qu'aux Aït Izdeg ansi signifie « endroit » - Ansi i d kkid = « De quel endroit viens-tu? ». Et il en est ainsi de tous les mots qui suivent, tous connus en Kabylie et dont le sens s'éclaire quand on les rapproche des mots berbères employés dans différents dialectes marocains. [Suit une liste d'une cinquantaine de mots kabyles obscurs rapprochés de termes marocains.]