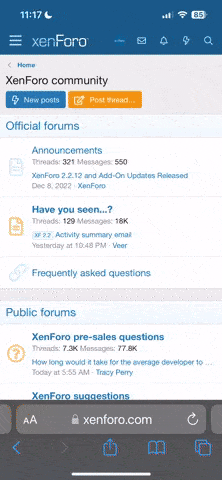Système éducatif
Entre-t-on dans la postarabisation?
· Un bilinguisme cohérent et équilibré entre l’arabe et le français serait la solution idéale
· Les lauréats seraient alors mieux préparés à faire face aux exigences du marché du travail
«On ne naît pas citoyen, mais on le devient, l’école le permet». A partir de ce phrasé, une éducation de qualité est donc indispensable pour construire l’identité individuelle et nationale, ainsi que pour former un citoyen conscient de ses droits et ses devoirs envers la collectivité, capable non seulement de recevoir, mais aussi de contribuer au bien être collectif.
«C’est pour cette raison que notre collectif s’implique dans le champ éducatif dans l’espoir de mobiliser acteurs et intervenants et d’effectuer une analyse pragmatique des projets et programmes en cours. Le Maroc a fait de gros progrès dans le domaine, les résultats sont parfois remarquables. Néanmoins, de nombreux Marocains sont des laissés-pour-compte dans le système actuel», précise le Pr Driss Moussaoui, président du collectif “Démocratie et modernité”.
L’implication de la structure associative vient de se traduire par l’organisation d’assises (à la faculté de médecine de Casablanca) avec comme thématique: “Quelle éducation pour un Maroc démocratique et moderne?”. Si l’initiative est noble, on peut toutefois regretter la faible mobilisation du grand public malgré un contenu riche, mais, il est vrai, légèrement décousu.
Que faut-il donc en déduire?! Avant d’aller vite en besogne, il paraît judicieux de prendre de la hauteur.
Rappelons-nous ce qui s’est déroulé à la fin des années 90 lorsque la Commission spéciale de l’enseignement et de la formation (COSEF) avait décidé de sensibiliser la population autour de l’élaboration de la Charte de l’Education nationale (réalisée en 1999). Cela avait donné lieu à peu de mobilisation.
Même effet en France lorsque le gouvernement Raffarin I, avec à sa tête le ministre de l’Education nationale (de l’époque), François Fillon, décidait d’ouvrir le débat sur l’enseignement à travers tout le pays. On ne peut pas dire que la mobilisation a marqué les esprits alors que l’action était louable et que des moyens importants (campagnes de sensibilisation, repères publicitaires, plaquettes, …) étaient déployés. Et ce, alors que l’opinion publique faisait feu de tout bois (campagne présidentielle 2002) et avait manifesté un intérêt majeur pour les questions liées à l’enseignement, l’éducation, la sécurité au sein des établissements, avec en ligne de mire la politique en vigueur et le corps professoral qui était pointé du doigt (niveau scolaire en baisse, marginalisation des élèves dès l’entrée au collège…).
· «La critique est aisée et l’art est difficile»
Au Maroc, le contexte est différent, mais la volonté de débattre, de critiquer, de proposer … est d’actualité, à l’heure où de nombreux chantiers sont ouverts, dont celui du système éducatif. L’initiative du comité “Démocratie et modernité” s’inscrit pleinement dans cette philosophie.
Si notre système éducatif a été évalué à plusieurs reprises par des instances nationales et internationales compétentes, la dernière évolution, assortie de propositions concrètes, a donné lieu à la Charte de l’éducation et de la formation de la Cosef, en 1999. A-t-elle permis d’identifier avec suffisamment de clairvoyance les points forts et les points faibles? Pour Ahmed Boukouss, recteur à l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), «l’opérationnalisation de la réforme est l’affaire de tous. Aussi ne vais-je pas m’aventurer à formuler un jugement lapidaire d’autant plus que, comme chacun sait, la critique est aisée et l’art est difficile!». Ce dernier précise que de nombreuses réalisations en matière d’éducation ont été concrétisées depuis l’Indépendance (organisation du ministère, des curricula et des programmes, marocanisation des cadres, scolarisation…). «En 50 ans, il y a eu non seulement de la quantité en termes d’effectifs scolarisés, mais aussi de la qualité en terme de formation des élites, d’ingénieurs, médecins, chercheurs, avocats…Toutefois, il reste beaucoup d’efforts à accomplir pour réussir la mise à niveau de notre éducation tant les défis et les enjeux sont multiples et multiformes», indique Ahmed Boukouss.
Quels sont les leviers stratégiques à impulser? «Il faut impérativement agir, en premier lieu, sur la formation des instituteurs, car ils sont mal formés, mal conseillés, mal encadrés… et mal payés. Un plan de formation doit leur être proposé dans le cadre de la mise à niveau avec un examen d’évaluation tous les deux ans par exemple, et ce, dans les plus brefs délais», préconise Rachid Benmokhtar, président de l’université Al Akhawayne (et ancien ministre de l’Education nationale entre 1995/98). Quant à Ahmed Boukouss, il tient à rappeller que «la qualité de l’éducation est en rapport direct avec la qualité des ressources humaines engagées dans le système éducatif».
Autre interrogation, quelle(s) langue(s) d’enseignement pour l’éducation? Le recteur de l’IRCAM avoue qu’il lui est difficile de répondre de manière directe, tant sa compréhension est obnubilée par des facteurs politiques et idéologiques. Si, dans la majorité des pays, la langue d’enseignement adoptée est la langue officielle qu’elle le soit de jure ou de facto. Il arrive cependant que, dans certains pays en développement, on pratique la bilinguité de substitution.
Qu’est-ce que c’est que cet “oiseau”? C’est tout simplement que la langue d’enseignement adoptée durant les premières années de la scolarité est la langue première de l’élève et ensuite se substitue à elle la langue de l’ancienne puissance coloniale. Dans d’autres pays encore, c’est le régime de bilingualité fonctionnel qui est adopté, c’est le cas dans certains Etats aux USA, avec la pratique de l’anglais ou de l’espagnol. Et au Maroc? «C’est la confusion. Cela vient du fait que l’arabe et le français se trouvent en situation de compétition au lieu d’être complémentaires», déclare-t-il.
En effet, l’arabe est la langue d’enseignement dans le primaire, dans le secondaire (à l’exception des filières techniques et économiques) et dans le supérieur (en lettres et sciences humaines et sociales). La situation est encore plus complexe à la faculté de droit où il existe une section en arabe et une section française, voire en sciences économiques. Quant au français dans le supérieur, c’est la langue d’enseignement des sciences, de la technologie et des techniques. Au niveau de l’enseignement privé, la place du français est plus importante que celle de l’arabe. Rien n’a été oublié? Si, comment mettre de l’ordre dans ce désordre? On le voit, la situation est singulièrement complexe, sinon compliquée, en tous les cas incohérente. D’aucuns estiment qu’un bilinguisme cohérent et équilibré entre l’arabe et le français serait la solution idéale. Selon cette option, l’arabe fonctionnerait comme langue d’enseignement des matières dont le contenu est en rapport avec les valeurs nationales, religieuses et patrimoniales. Et le français serait la langue d’enseignement des matières scientifiques et techniques. En quelque sorte, ce serait un retour à la situation post-arabisation. «Elle aurait l’avantage de mieux préparer les lauréats à faire face aux exigences du marché du travail dans le contexte de la globalisation déferlante», conclut Ahmed Boukouss.
L’amazigh, 2 ans après…
Parler de bilan au bout de 2 années seulement d’introduction de la langue amazighe (à l’école primaire CP) peut paraître insuffisant, néanmoins, nous avons demandé à Ahmed Boukouss de s’exprimer sur le sujet. «C’est tout d’abord un événement majeur dans l’histoire du système éducatif. Majeur, car il consacre le doit à l’enseignement d’une langue nationale (identité collective, patrimoine commun), mais également parce qu’il prépare le devenir de la communauté nationale», annonce le recteur de l’IRCAM.
Au rayon des réalisations, il y a lieu de citer la confection d’outils pédagogiques, la formation des premiers noyaux d’enseignants (et de superviseurs pédagogiques) et la gestion au niveau des académies. Le processus de revalorisation et de promotion est-il confronté à des levées de bouclier sur le terrain? «Effectivement, des résistances s’expriment ouvertement ainsi que des blocages qui agissent en latence. Le dépassement de ces écueils nécessite de la part de chacun, non pas une attitude de découragement, mais d’avantage de travail au travers d’une approche politique faite d’ouverture et d’écoute, d’une stratégie de communication résolue et encore plus d’abnégation», insiste Ahmed Boukouss.
Rachid HALLAOUY
L'Economiste
Entre-t-on dans la postarabisation?
· Un bilinguisme cohérent et équilibré entre l’arabe et le français serait la solution idéale
· Les lauréats seraient alors mieux préparés à faire face aux exigences du marché du travail
«On ne naît pas citoyen, mais on le devient, l’école le permet». A partir de ce phrasé, une éducation de qualité est donc indispensable pour construire l’identité individuelle et nationale, ainsi que pour former un citoyen conscient de ses droits et ses devoirs envers la collectivité, capable non seulement de recevoir, mais aussi de contribuer au bien être collectif.
«C’est pour cette raison que notre collectif s’implique dans le champ éducatif dans l’espoir de mobiliser acteurs et intervenants et d’effectuer une analyse pragmatique des projets et programmes en cours. Le Maroc a fait de gros progrès dans le domaine, les résultats sont parfois remarquables. Néanmoins, de nombreux Marocains sont des laissés-pour-compte dans le système actuel», précise le Pr Driss Moussaoui, président du collectif “Démocratie et modernité”.
L’implication de la structure associative vient de se traduire par l’organisation d’assises (à la faculté de médecine de Casablanca) avec comme thématique: “Quelle éducation pour un Maroc démocratique et moderne?”. Si l’initiative est noble, on peut toutefois regretter la faible mobilisation du grand public malgré un contenu riche, mais, il est vrai, légèrement décousu.
Que faut-il donc en déduire?! Avant d’aller vite en besogne, il paraît judicieux de prendre de la hauteur.
Rappelons-nous ce qui s’est déroulé à la fin des années 90 lorsque la Commission spéciale de l’enseignement et de la formation (COSEF) avait décidé de sensibiliser la population autour de l’élaboration de la Charte de l’Education nationale (réalisée en 1999). Cela avait donné lieu à peu de mobilisation.
Même effet en France lorsque le gouvernement Raffarin I, avec à sa tête le ministre de l’Education nationale (de l’époque), François Fillon, décidait d’ouvrir le débat sur l’enseignement à travers tout le pays. On ne peut pas dire que la mobilisation a marqué les esprits alors que l’action était louable et que des moyens importants (campagnes de sensibilisation, repères publicitaires, plaquettes, …) étaient déployés. Et ce, alors que l’opinion publique faisait feu de tout bois (campagne présidentielle 2002) et avait manifesté un intérêt majeur pour les questions liées à l’enseignement, l’éducation, la sécurité au sein des établissements, avec en ligne de mire la politique en vigueur et le corps professoral qui était pointé du doigt (niveau scolaire en baisse, marginalisation des élèves dès l’entrée au collège…).
· «La critique est aisée et l’art est difficile»
Au Maroc, le contexte est différent, mais la volonté de débattre, de critiquer, de proposer … est d’actualité, à l’heure où de nombreux chantiers sont ouverts, dont celui du système éducatif. L’initiative du comité “Démocratie et modernité” s’inscrit pleinement dans cette philosophie.
Si notre système éducatif a été évalué à plusieurs reprises par des instances nationales et internationales compétentes, la dernière évolution, assortie de propositions concrètes, a donné lieu à la Charte de l’éducation et de la formation de la Cosef, en 1999. A-t-elle permis d’identifier avec suffisamment de clairvoyance les points forts et les points faibles? Pour Ahmed Boukouss, recteur à l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), «l’opérationnalisation de la réforme est l’affaire de tous. Aussi ne vais-je pas m’aventurer à formuler un jugement lapidaire d’autant plus que, comme chacun sait, la critique est aisée et l’art est difficile!». Ce dernier précise que de nombreuses réalisations en matière d’éducation ont été concrétisées depuis l’Indépendance (organisation du ministère, des curricula et des programmes, marocanisation des cadres, scolarisation…). «En 50 ans, il y a eu non seulement de la quantité en termes d’effectifs scolarisés, mais aussi de la qualité en terme de formation des élites, d’ingénieurs, médecins, chercheurs, avocats…Toutefois, il reste beaucoup d’efforts à accomplir pour réussir la mise à niveau de notre éducation tant les défis et les enjeux sont multiples et multiformes», indique Ahmed Boukouss.
Quels sont les leviers stratégiques à impulser? «Il faut impérativement agir, en premier lieu, sur la formation des instituteurs, car ils sont mal formés, mal conseillés, mal encadrés… et mal payés. Un plan de formation doit leur être proposé dans le cadre de la mise à niveau avec un examen d’évaluation tous les deux ans par exemple, et ce, dans les plus brefs délais», préconise Rachid Benmokhtar, président de l’université Al Akhawayne (et ancien ministre de l’Education nationale entre 1995/98). Quant à Ahmed Boukouss, il tient à rappeller que «la qualité de l’éducation est en rapport direct avec la qualité des ressources humaines engagées dans le système éducatif».
Autre interrogation, quelle(s) langue(s) d’enseignement pour l’éducation? Le recteur de l’IRCAM avoue qu’il lui est difficile de répondre de manière directe, tant sa compréhension est obnubilée par des facteurs politiques et idéologiques. Si, dans la majorité des pays, la langue d’enseignement adoptée est la langue officielle qu’elle le soit de jure ou de facto. Il arrive cependant que, dans certains pays en développement, on pratique la bilinguité de substitution.
Qu’est-ce que c’est que cet “oiseau”? C’est tout simplement que la langue d’enseignement adoptée durant les premières années de la scolarité est la langue première de l’élève et ensuite se substitue à elle la langue de l’ancienne puissance coloniale. Dans d’autres pays encore, c’est le régime de bilingualité fonctionnel qui est adopté, c’est le cas dans certains Etats aux USA, avec la pratique de l’anglais ou de l’espagnol. Et au Maroc? «C’est la confusion. Cela vient du fait que l’arabe et le français se trouvent en situation de compétition au lieu d’être complémentaires», déclare-t-il.
En effet, l’arabe est la langue d’enseignement dans le primaire, dans le secondaire (à l’exception des filières techniques et économiques) et dans le supérieur (en lettres et sciences humaines et sociales). La situation est encore plus complexe à la faculté de droit où il existe une section en arabe et une section française, voire en sciences économiques. Quant au français dans le supérieur, c’est la langue d’enseignement des sciences, de la technologie et des techniques. Au niveau de l’enseignement privé, la place du français est plus importante que celle de l’arabe. Rien n’a été oublié? Si, comment mettre de l’ordre dans ce désordre? On le voit, la situation est singulièrement complexe, sinon compliquée, en tous les cas incohérente. D’aucuns estiment qu’un bilinguisme cohérent et équilibré entre l’arabe et le français serait la solution idéale. Selon cette option, l’arabe fonctionnerait comme langue d’enseignement des matières dont le contenu est en rapport avec les valeurs nationales, religieuses et patrimoniales. Et le français serait la langue d’enseignement des matières scientifiques et techniques. En quelque sorte, ce serait un retour à la situation post-arabisation. «Elle aurait l’avantage de mieux préparer les lauréats à faire face aux exigences du marché du travail dans le contexte de la globalisation déferlante», conclut Ahmed Boukouss.
L’amazigh, 2 ans après…
Parler de bilan au bout de 2 années seulement d’introduction de la langue amazighe (à l’école primaire CP) peut paraître insuffisant, néanmoins, nous avons demandé à Ahmed Boukouss de s’exprimer sur le sujet. «C’est tout d’abord un événement majeur dans l’histoire du système éducatif. Majeur, car il consacre le doit à l’enseignement d’une langue nationale (identité collective, patrimoine commun), mais également parce qu’il prépare le devenir de la communauté nationale», annonce le recteur de l’IRCAM.
Au rayon des réalisations, il y a lieu de citer la confection d’outils pédagogiques, la formation des premiers noyaux d’enseignants (et de superviseurs pédagogiques) et la gestion au niveau des académies. Le processus de revalorisation et de promotion est-il confronté à des levées de bouclier sur le terrain? «Effectivement, des résistances s’expriment ouvertement ainsi que des blocages qui agissent en latence. Le dépassement de ces écueils nécessite de la part de chacun, non pas une attitude de découragement, mais d’avantage de travail au travers d’une approche politique faite d’ouverture et d’écoute, d’une stratégie de communication résolue et encore plus d’abnégation», insiste Ahmed Boukouss.
Rachid HALLAOUY
L'Economiste