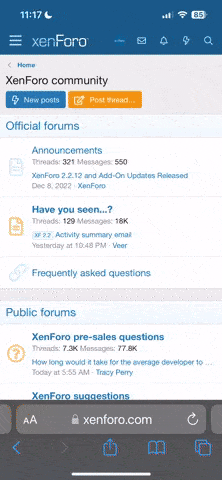Il faut tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de parler… Au chapitre des questions délicates, la problématique linguistique est parmi celles qui cristallisent les revendications identitaires, nourrissant les débats. Dans toutes les langues. Revendications amazighophones, combat en faveur de la darija, soutien du bilinguisme franco-arabe, défense de l’arabe classique, langue du Coran et vecteur de cohésion avec les nations arabo-musulmanes.
Dernièrement, c’est un député de la région d’Agadir-Inezgane qui crée la polémique lors d’une séance parlementaire, transmise en direct à la télévision nationale le 7 novembre. Mohamed Oumouloud, d’origine amazigh, parlant arabe a choisi de poser une question relative au pouvoir d’achat en tachelhit, au risque de ne pas se faire comprendre par une large partie de la population laquelle, tout en respectant cette langue, ne la maîtrise pas forcément, même en milieu berbère, tarifit à titre d’exemple.
Plus anciennement, c’est le magazine «Nichane» en darija qui fait les grands titres avec son éditorial, appelé en arabe (?!) dialectal «Dirict» (Note du traducteur: déformation du français Direct).
L’affaire étant en instruction, nous nous abstiendrons d’en dire plus, si ce n’est cette mention de la ligne éditoriale globale du magazine avec sa mise en avant franche et assumée de la darija. Un dialecte que d’aucuns veulent promouvoir au statut de langue officielle, enseignée à l’école, devant les cris outragés des puristes. Comment aborder donc toutes ces questions, en allant dans le sens du rapprochement des différentes visions, évitant la radicalisation du débat? La mise en perspective historique ayant l’avantage de relativiser et d’éclairer les esprits, osons donc un petit survol de l’évolution linguistique dans notre pays, malgré toute la complexité de cette entreprise. La première leçon d’histoire dispensée à l’école nous apprend que les habitants autochtones du Maroc sont les Berbères. Le berbère reste de ce fait la langue la plus anciennement parlée, ayant probablement existé à l’état homogène, selon quelques chercheurs, avant d’éclater en plusieurs idiomes. D’autres spécialistes sont plus proches des théories d’Ibn Khaldoun sur la classification des Berbères en trois branches. La première serait formée par les sédentaires Masmouda, résidant depuis Sebta, jusqu’au Souss-Extrême. La deuxième serait constituée par les nomades chameliers Sanhaja, des Sahariens probablement de souche yéménite, formant plusieurs enclaves en pays Masmouda, bien avant l’avènement de l’Empire almoravide dont ils sont les fondateurs. Enfin, troisième branche, également dotée d’innombrables ramifications: les cavaliers Zenata. Berbères orientaux, venus du sud de l’Egypte, des régions de Tripolitaine ou du sud de la Tunisie, ils sont assimilés aux peuples anciens des Garamantes et ont des mœurs très proches de celles des Arabes. Ces divers groupes, mêlés depuis des siècles, parlent tous une langue, dite tamazight, divisée en trois principaux dialectes au Maroc: le tarifit dans le Rif, le tamazight dans le Moyen-Atlas et le tachelhit dans le Souss.
Dans son ouvrage dédié à Trente-trois siècles d’histoire des Imazighen, le professeur Mohamed Chafik met en avant la part de la culture berbère dans les civilisations gréco-romaines.
De même, ces cultures méditerranéennes ont laissé des empreintes significatives, depuis l’arrivée des Phéniciens des côtes du Liban, inspirant l’écriture berbère, dite Tifinagh. Le linguiste Salem Chaker voit en effet dans cet alphabet, une origine phénicienne. Il nous rappelle ainsi les théories d’un Adolphe Hanoteau sur le dérivé du mot Tifinagh, de Tafniq, la Phénicienne.
Ouverts aux cultures étrangères, les Berbères adoptent le latin et laissent de belles productions dans cette langue avec des auteurs comme Saint-Augustin pour les écrits théologiques ou Apulée dans la catégorie ouvrages philosophiques, dont le plus célèbre est «L’âne d’or ou les Métamorphoses».
Au Maroc, tout en développant une langue ancienne, les Berbères ont peu fixé par écrit leur tradition littéraire et ont privilégié notamment l’usage esthétique du langage, érigeant comme genres majeurs, le poème, le conte, la légende...
Avec l’arrivée de l’Islam, l’arabisation reste superficielle, limitée qu’elle était aux grands centres urbains. Contrairement aux préjugés relatifs à la Conquête, les Arabes n’ont pas dépassé les 13.000 hommes, accompagnés dans leur lancée par des Berbères orientaux Zénètes. Parmi les épisodes marquants se rattachant à cette époque, signalons la traduction du Coran en berbère au VIIIe siècle par le faux prophète des Berghouata. Une entreprise vigoureusement dénoncée, pas tant à cause de la traduction en elle-même que de la dénaturation du message coranique.
Par ailleurs, pendant le Haut Moyen-Âge, quelques Berbères lettrés ont livré en tachelhit des productions hagiographiques ou poétiques, transcrites en caractères arabes.
Au XIIe siècle, avec l’arrivée massive, des tribus bédouines Béni Hilal, l’histoire socioculturelle du Maroc connaît un tournant décisif. Déplacées par le sultan almohade Yaâqoub el-Mansour sur les plaines atlantiques, avec femmes et enfants, ces tribus, suivies par les Maâqil d’origine yéménite, contribuent à arabiser en profondeur le monde rural.
Elles portent toutes dans leurs bagages, leurs traditions culturelles dont l’épopée de leur Taghriba (ou Marche vers l’Ouest), dite geste des Béni Hilal qui alimenta de nombreux contes, faisant les joies des veillées nocturnes familiales ou des halqa des places publiques.
C’est probablement de ces périodes que datent les prémisses de la formation du dialectal, fait de toutes ces interpénétrations arabo-berbères. Il est remarquable de constater dans ce cadre, le nombre d’emprunts que le dialectal doit au vocabulaire berbère, de même que toutes les similitudes syntaxiques.
Sur le plan littéraire prospéra également, à côté d’une littérature savante, en arabe classique, un riche patrimoine oral millénaire en dialectal, notamment dans le registre de la poésie populaire dont l’un des fleurons est le Zajal.
Né en Andalousie aux alentours du XIe siècle, le Zajal gagna l’ensemble du monde arabe et passa de l’oralité à l’écriture à travers les siècles, inspirant de nombreux artistes dont le grand parolier et homme de théâtre Ahmed Tayeb Laâlaj.
Toujours dans la catégorie du parler dialectal et de ses productions poétiques, loin des structures traditionnelles, comment ne pas évoquer le Melhoun, d’origine bédouine dont l’un des dignes représentants au XXe siècle est Hajj Houcine Toulali.
Dernièrement, c’est un député de la région d’Agadir-Inezgane qui crée la polémique lors d’une séance parlementaire, transmise en direct à la télévision nationale le 7 novembre. Mohamed Oumouloud, d’origine amazigh, parlant arabe a choisi de poser une question relative au pouvoir d’achat en tachelhit, au risque de ne pas se faire comprendre par une large partie de la population laquelle, tout en respectant cette langue, ne la maîtrise pas forcément, même en milieu berbère, tarifit à titre d’exemple.
Plus anciennement, c’est le magazine «Nichane» en darija qui fait les grands titres avec son éditorial, appelé en arabe (?!) dialectal «Dirict» (Note du traducteur: déformation du français Direct).
L’affaire étant en instruction, nous nous abstiendrons d’en dire plus, si ce n’est cette mention de la ligne éditoriale globale du magazine avec sa mise en avant franche et assumée de la darija. Un dialecte que d’aucuns veulent promouvoir au statut de langue officielle, enseignée à l’école, devant les cris outragés des puristes. Comment aborder donc toutes ces questions, en allant dans le sens du rapprochement des différentes visions, évitant la radicalisation du débat? La mise en perspective historique ayant l’avantage de relativiser et d’éclairer les esprits, osons donc un petit survol de l’évolution linguistique dans notre pays, malgré toute la complexité de cette entreprise. La première leçon d’histoire dispensée à l’école nous apprend que les habitants autochtones du Maroc sont les Berbères. Le berbère reste de ce fait la langue la plus anciennement parlée, ayant probablement existé à l’état homogène, selon quelques chercheurs, avant d’éclater en plusieurs idiomes. D’autres spécialistes sont plus proches des théories d’Ibn Khaldoun sur la classification des Berbères en trois branches. La première serait formée par les sédentaires Masmouda, résidant depuis Sebta, jusqu’au Souss-Extrême. La deuxième serait constituée par les nomades chameliers Sanhaja, des Sahariens probablement de souche yéménite, formant plusieurs enclaves en pays Masmouda, bien avant l’avènement de l’Empire almoravide dont ils sont les fondateurs. Enfin, troisième branche, également dotée d’innombrables ramifications: les cavaliers Zenata. Berbères orientaux, venus du sud de l’Egypte, des régions de Tripolitaine ou du sud de la Tunisie, ils sont assimilés aux peuples anciens des Garamantes et ont des mœurs très proches de celles des Arabes. Ces divers groupes, mêlés depuis des siècles, parlent tous une langue, dite tamazight, divisée en trois principaux dialectes au Maroc: le tarifit dans le Rif, le tamazight dans le Moyen-Atlas et le tachelhit dans le Souss.
Dans son ouvrage dédié à Trente-trois siècles d’histoire des Imazighen, le professeur Mohamed Chafik met en avant la part de la culture berbère dans les civilisations gréco-romaines.
De même, ces cultures méditerranéennes ont laissé des empreintes significatives, depuis l’arrivée des Phéniciens des côtes du Liban, inspirant l’écriture berbère, dite Tifinagh. Le linguiste Salem Chaker voit en effet dans cet alphabet, une origine phénicienne. Il nous rappelle ainsi les théories d’un Adolphe Hanoteau sur le dérivé du mot Tifinagh, de Tafniq, la Phénicienne.
Ouverts aux cultures étrangères, les Berbères adoptent le latin et laissent de belles productions dans cette langue avec des auteurs comme Saint-Augustin pour les écrits théologiques ou Apulée dans la catégorie ouvrages philosophiques, dont le plus célèbre est «L’âne d’or ou les Métamorphoses».
Au Maroc, tout en développant une langue ancienne, les Berbères ont peu fixé par écrit leur tradition littéraire et ont privilégié notamment l’usage esthétique du langage, érigeant comme genres majeurs, le poème, le conte, la légende...
Avec l’arrivée de l’Islam, l’arabisation reste superficielle, limitée qu’elle était aux grands centres urbains. Contrairement aux préjugés relatifs à la Conquête, les Arabes n’ont pas dépassé les 13.000 hommes, accompagnés dans leur lancée par des Berbères orientaux Zénètes. Parmi les épisodes marquants se rattachant à cette époque, signalons la traduction du Coran en berbère au VIIIe siècle par le faux prophète des Berghouata. Une entreprise vigoureusement dénoncée, pas tant à cause de la traduction en elle-même que de la dénaturation du message coranique.
Par ailleurs, pendant le Haut Moyen-Âge, quelques Berbères lettrés ont livré en tachelhit des productions hagiographiques ou poétiques, transcrites en caractères arabes.
Au XIIe siècle, avec l’arrivée massive, des tribus bédouines Béni Hilal, l’histoire socioculturelle du Maroc connaît un tournant décisif. Déplacées par le sultan almohade Yaâqoub el-Mansour sur les plaines atlantiques, avec femmes et enfants, ces tribus, suivies par les Maâqil d’origine yéménite, contribuent à arabiser en profondeur le monde rural.
Elles portent toutes dans leurs bagages, leurs traditions culturelles dont l’épopée de leur Taghriba (ou Marche vers l’Ouest), dite geste des Béni Hilal qui alimenta de nombreux contes, faisant les joies des veillées nocturnes familiales ou des halqa des places publiques.
C’est probablement de ces périodes que datent les prémisses de la formation du dialectal, fait de toutes ces interpénétrations arabo-berbères. Il est remarquable de constater dans ce cadre, le nombre d’emprunts que le dialectal doit au vocabulaire berbère, de même que toutes les similitudes syntaxiques.
Sur le plan littéraire prospéra également, à côté d’une littérature savante, en arabe classique, un riche patrimoine oral millénaire en dialectal, notamment dans le registre de la poésie populaire dont l’un des fleurons est le Zajal.
Né en Andalousie aux alentours du XIe siècle, le Zajal gagna l’ensemble du monde arabe et passa de l’oralité à l’écriture à travers les siècles, inspirant de nombreux artistes dont le grand parolier et homme de théâtre Ahmed Tayeb Laâlaj.
Toujours dans la catégorie du parler dialectal et de ses productions poétiques, loin des structures traditionnelles, comment ne pas évoquer le Melhoun, d’origine bédouine dont l’un des dignes représentants au XXe siècle est Hajj Houcine Toulali.