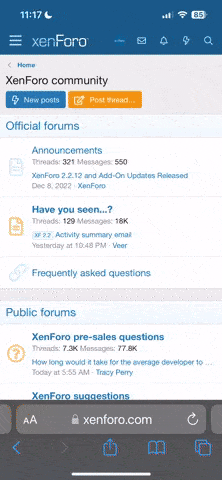Cycliquement, l’idée d’un parti amazigh refait surface. Aujourd’hui, Omar Louzi a franchi le pas. Le projet du Parti Démocrate Amazigh gêne au ministère de l’Intérieur. Quant aux grands noms de la cause, ils se contentent de l’encourager de loin.
Depuis le 27 mai 2005, date à laquelle Omar Louzi a déposé le dossier du Parti Démocrate Amazigh (PDA) à la wilaya de Rabat-Salé, les réactions s’enchaînent. Au Mouvement Populaire, parti où Louzi avait fait ses premières armes avant de s’y sentir à l’étroit, ce nouveau-né est vu comme un intrus.
"En tout cas, commente un dirigeant haraki, la nouvelle loi n’autorise pas de parti dont la dénomination révèle son origine ethnique". Au ministère de l’Intérieur, ce responsable requérant l’anonymat est plus précis : "Ce projet ne peut être jugé à l’aune de la nouvelle loi sur les partis, car il lui est antérieur. Par ailleurs, nos services jugent un parti plus par ses objectifs que par son nom". Concernant les objectifs, un débat interne au PJD sonne le glas : la défense de la laïcité et de la diversité religieuse (par le PDA) y a été vivement critiquée. Enfin, derniers tracas en date, le passeport de Louzi n’a pas été renouvelé. Y a-t-il un lien avec l’amazighité affichée du PDA ? "Tout porte à le croire", estime l’intéressé.
Au sein de la communauté des Imazighen, deux attitudes prévalent. D’un côté, les plus sages prônent, selon Ahmed Assid "l’encouragement de toute initiative qui aide à pousser la cause amazighe ne serait-ce que d’un iota". En face, apparaît une attitude plus jalouse, réticente, émanant de certains leaders associatifs (il y en a 121 en tout) qui rechignent sur l’identité des hommes devant les représenter à un niveau partisan. Pour certains, Louzi demeure un "trublion, provocateur". Ce militant se rappelle de cette anecdote en 1991. Convié au haut conseil de la culture (il y en avait un au temps d’Allal Sinaceur), le jeune Louzi s’était présenté avec un chapeau de cow-boy et avait commencé à parler en français. Lorsque le très nationaliste Abdelkrim Ghallab l’a prié de s’exprimer dans la langue nationale, il a switché en tamazight. Cela prouve, aux yeux des plus optimistes, que Louzi va jusqu’au bout de ses idées. Sauf que, traditionnellement, prévient Assid : "La culture nous unit et la politique nous désunit". D’où vient ce blocage ?
Histoire d’un rêve reporté
La volonté de passer du cadre exigu de l’association à celui, plus large et politique, de parti, date de 1997. Le comité national de coordination de la cause Amazighe, qui regroupait à l’époque 32 associations, était en réunion à Fès. L’ère Hassan II touchait à sa fin. Même les revendications culturelles les plus basiques, relatives à la médiatisation, l’enseignement, la graphie, la recherche, se heurtaient à une fin de non-recevoir. Pour la première fois, les militants, sortant à peine d’années de persécution, osent proposer l’option du parti en discussion. Finalement, face à des divergences de stratégie, entre ceux qui cherchaient le soutien international et ceux qui préféraient s’en tenir à leur réseau national, l’idée tombe à l’eau et même le comité qui lui a donné naissance vole en éclats.
Lorsqu’en 2000, Mohamed Chafiq convie ses amis à adopter le Manifeste Amazigh, la méfiance est toujours de mise. Les participants viennent à titre personnel, sans référence à leurs chapelles respectives. Et parmi les plate formes soumises à discussion, celle du très contesté Ahmed Dgharni propose la création d’un parti de Tamazgha. Surprise, sur les 152 voix présentes, 6 seulement soutiennent son projet. N’acceptant pas cette posture de minoritaire, il fera cavalier seul, annonçant la création du parti, nonobstant le refus des autres, ce qui lui vaut le désaveu de toute la mouvance. L’une des entraves majeures à l’idée de parti, se souvient Assid, "était l’absence d’un leader national ayant une légitimité historique". Coïncidence ou fatalité, aussi bien Mohamed Bensaïd Aït Idder que le fqih Basri –pour ne citer que les plus illustres- ont opté pour la gauche panarabiste.
Un parti, au nom du père
Le père de Omar, le fameux Haddou Louzi est un cran au-dessous de ces leaders, mais garde à Goulmima (sa région) l’image légendaire d’un indomptable ittihadi, fier de son amazighité. Aussi bien architecte que financier de l’insurrection de Moulay Bouazza en mars 1973, ce fondateur de la société pétrolière Ziz, riche propriétaire et insoumis, a fini par quitter le pays fuyant ainsi une condamnation à mort par contumace. Délesté arbitrairement de tous ses biens, il sera gracié aux côtés d’un certain Abderrahmane Youssoufi en 1980. C’est frustré par une fortune paternelle non restituée (140 millions de dirhams confiqués), mais aussi fort du patrimoine d’un père digne qui ne courbera jamais l’échine (il est mort en 1997) que Omar Louzi décide de reprendre le flambeau.
En 2003, Louzi, le militant amazigh, a déjà fait son deuil du Mouvement Populaire, où "Aherdane et compagnie croient en la cause individuellement, mais jamais en tant que parti". Il s’est également fait une raison : "Impossible de promouvoir la culture amazighe dans des régions rurales, surtout, où les gens sont dans le dénuement total". Il a aussi une double conviction de vert, qui a longtemps vécu en Suisse et de laïc qu’il tient de sa tradition où l’amghar (le chef de la tribu) nomme le fqih. Et il parvient à convaincre 47 personnes (majoritairement issues de familles d’ex-détenus) de lancer le parti amazigh longtemps rêvé. Cela fait un an et demi qu’ils se rencontrent, discutent, planifient. Un comité préparatoire, ne comportant pas de noms illustres, multiplie les rencontres, avec les partis, la presse et le réseau de soutien affilié au groupement des peuples autochtones. Aujourd’hui, même si les autorités semblent réticentes, une date est fixée pour le congrès. "Ce sera le 15 novembre, si tout va bien", dit Louzi en croisant les doigts.
Une idée noble, mais…
"La question n’est pas de savoir si le parti naîtra, mais si les fondateurs sont capables de le faire vivre", dit ce militant amazigh de longue date. En effet, durant la dernière rencontre tenue à Meknès et au sein de l’IRCAM, les discussions vont bon train dans les coulisses. Tout le monde s’accorde à dire que l’inscription du tamazight dans la Constitution nécessite une structure politique. "Est-ce forcément un parti ? Pourquoi pas un lobby ?" Rien n’est tranché. Mais si la réticence vis-à-vis du parti est toujours de mise, explique Assid, c’est bien parce que "le capital de sympathie du mouvement associatif demeure limité, que seuls les étudiants, les enseignants et les avocats nous suivent et que la population commerciale demeure hors d’atteinte". Louzi et compagnie auraient-ils des bailleurs de fonds pour les soutenir ? Aucun signe n’apparaît dans ce sens. Par contre, les détracteurs ne manquent pas. Dernier en date, Dgharni, le banni du mouvement, a quasiment dupliqué le projet du PDA et l’a déposé en son nom début juillet. Un dissident ? Même pas. Un trouble fête.
Faut-il croire que les Imazighen n’arriveront fatalement pas à s’unir politiquement ? On a beau croire qu’ils peuvent conjurer le sort. Mais les faits sont têtus.
SOURCE